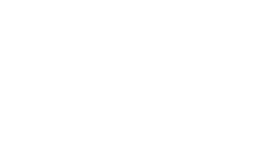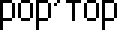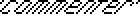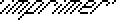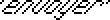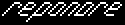« A pioneer world », 2001.
© Art Orienté Objet
< 31'03'09 >
Art Orienté Objet : « J’ai ressenti dans mon corps la nature très vive du cheval »
« Nouveaux monstres », affiche l’exposition phare d’Exit 09, avec une multiplicité de variations autour de la figure de l’alien, cet autre envisagé comme lointain, chimérique, forcément un peu diabolique. Pourtant, depuis le cyborg, cet hybride de l’humain et du robot, jusqu’aux récentes manipulations du vivant, le monstre échappe à sa caricature.
Du lapin vert fluo génétiquement modifié d’Eduardo Kac à l’oreille greffée sur le bras de Stelarc, de l’artiste transpirant en bleu (Yann Marussich) aux expériences chevalines d’Art Orienté Objet (Marion Laval-Jeantet se fait injecter du sang de cheval en intraveineuse), les expérimentations des artistes du bio-art questionnent et repoussent les limites du vivant, à mi-chemin de la science et de la philosophie. Elles posent des questions essentielles que nos sociétés pressées ont tendance à occulter : jusqu’où peut-on manipuler le vivant, les cauchemars des auteurs de SF n’ont-ils pas déjà une réalité à l’heure des greffes de visage et des OGM ? Ces artistes sont-ils les apprentis sorciers des biotechnologies ? Comment évaluer la portée de leurs travaux ? En attendant la conférence menée ce jour à Créteil par Cyril Thomas et Annick Rivoire, Poptronics a rencontré
Marion Laval-Jeantet (en partenariat avec la revue « Patch » du Centre des écritures contemporaines et numériques CECN). Avec Benoît Mangin, ils ont fondé Art Orienté Objet il y a un peu moins de 20 ans, en 1991, et construisent depuis une œuvre singulière autour des sciences du vivant, entre ethnologie, ethnopsychiatrie et bio-technologies. Ils questionnent notre rapport à l’animalité ou encore les manipulations génétiques qui transforment notre rapport au monde.
Le rapport à la science est très présent dans vos œuvres, qu’elles traitent des animaux comme « A Pioneer World » en 2001, ou mettent en scène le laboratoire et ses expérimentations.
La question de l’animalité nous travaille. L’art existe pour élargir les limites de la conscience et par conséquent pour chercher à comprendre l’Autre. L’animal, c’est aussi un autre. L’œuvre sur laquelle nous travaillons en ce moment est au cœur de ce rapport à l’animal en tant qu’autre. Cette œuvre qui consistera à m’injecter du sang de cheval est en cours de finalisation. Elle peut s’appréhender comme une œuvre issue du body-art, mais demeure associée aux préoccupations du bio-art : il a fallu rendre compatible mon sang avec celui du cheval mais également me rendre compatible avec cet autre type sanguin. En somme, nous faisons un pas vers le cheval comme le cheval effectue lui-même un pas vers l’humain.
En tentant de telles hybridations sanguines, êtes-vous du côté de l’expérimentation scientifique ou artistique ?
Cette pièce résulte d’une collaboration de longue haleine avec plusieurs laboratoires, l’un en France, les autres en Suisse et en Slovénie. Cette œuvre tente de comprendre, d’examiner et de déterminer si nous pouvons nous hybrider nous-mêmes. Nous essayons de calculer, de cerner tous les risques encourus mais l’impact de cette transfusion demeure inconnu. Notre démarche reste très empirique. J’ai déjà été sensibilisée à plusieurs immunoglobulines (c’est-à-dire des protéines) chevalines. Depuis plusieurs années, je me soumets à un suivi médical sérieux pour préparer cette pièce, qui continuera bien après la transfusion car l’injection risque de laisser des traces dans l’organisme… La recherche scientifique demeure encore assez imprécise. Les scientifiques connaissent les effets que certaines immunoglobulines produisent séparément sur l’organisme, mais leurs effets combinés demeurent inconnus. On avance pas à pas. Il reste de nombreuses zones d’ombre, notamment en ce qui concerne l’élimination de ce sang animal. Les chercheurs ont confiance dans la capacité du corps humain à éliminer des corps ou des substances étrangères à l’organisme.
C’est une expérimentation dont on ne peut pas encore mesurer les conséquences. Une expérience qui s’ancre dans notre contemporain et qui interroge vraiment l’époque à laquelle elle se déroule. Comme dans nos « Cultures de peaux », la question du fétiche nous semble pertinente. Quel rituel adopter, s’il y en a un, lors de cette injection ? Quels seront les objets qui en découleront ? D’une certaine manière, ce projet rejoint les préoccupations artistiques des années soixante comme dans la « Merda d’Artista » de Piero Manzoni. Peut-être des flacons de mon sang, comparable à un sang mutant, à un sang hybridé verront-ils le jour ? Il est probable que ma vision des choses changera le temps que je serai influencée par cet autre sang.
Cette pièce est-elle estampillée bio-art et précisément, qu’est-ce que le bio-art selon vous, un art de la technologie ?
Le bio-art ne se réduit pas à un modèle technologique, c’est pour cela qu’il demeure indéfinissable. Etrangement, tout dépend du moment où vous faites démarrer le bio-art. Il n’y a pas une synergie volontaire autour du bio-art mais plutôt un consensus lié à l’époque, qui regroupe les recherches de plusieurs artistes et l’évolution des technologies… Historiquement, nous avons réalisé une des premières œuvres liées à ce mouvement sans qu’il soit encore défini : sur le moment, « Cultures de peaux d’artistes » et « French Paradox » (1996-1997) n’ont pas été compris, ni en France, ni en Hollande lors de leurs présentations à De Apple. Elles sont restées en suspens, jusqu’au moment où Jens Hauser (critique d’art et curateur d’expositions, dont l’Art Biotech au Lieu Unique à Nantes en 2003, ou sk-interfaces à Liverpool en 2008, ndlr) les a redécouvertes, alors qu’il s’intéressait aux œuvres de SymbioticA et à celles d’Eduardo Kac.
Nous sommes manifestement des artistes du bio-art mais nous ne sommes pas que cela, cette appellation nous semble trop réductrice. Depuis plus de seize ans, nos travaux portent sur un domaine particulier : la logique inhérente au vivant. Les trois « Musées Manifesto » (1997-1999) que nous avons conçus, celui des horreurs naturelles, celui des horreurs biologiques et celui des horreur mentales résument nos axes de recherches. L’animal, comme la plante, prend une place prépondérante. Nous partageons une sensibilité écologique ; c’est pourquoi nous avons travaillé sur l’Homme, sur l’Animal, sur les arbres, sur l’environnement, en les explorant d’un point de vue psychique ou en adoptant celui de la biologie interne… Dès notre première œuvre, nous avions élaboré un protocole de création où nous partions du terrain, nous l’expérimentions pour produire nos œuvres. Ce point de départ correspond à la définition de la programmation orientée objet en informatique.
Votre corps est partie prenante du dispositif artistique, la prise de risque aussi ?
Dans notre pratique, nous prenons des risques. Il y a quelques années, nous nous sommes rendus chez les Pygmées en Centre-Afrique, pour expérimenter les limites de la mort, voire tester une autre approche de la mort. Nous nous intéressons à d’autres processus de création, en utilisant par exemple ma formation en ethno-psychiatrie. Dans ce cas précis, le protocole consistait à ingérer un violent psychotrope, peu connu du monde occidental, utilisé lors des initiations pour devenir thérapeute. A un an d’intervalle, nous nous sommes volontairement plongés dans une sorte de coma, durant une nuit, pour approcher de très près un état de mort tout en conservant des traces dans notre mémoire... Puis, accompagnés par un sorcier, nous sommes revenus. D’une certaine manière, c’était le prolongement de nos recherches en bio-art. Cette expérience aura donné naissance à trois ouvrages différents, dont le dernier, bientôt publié, porte sur le devenir de cette expérience dans l’art.
Votre projet actuel d’hybridation sanguine poursuit d’une certaine manière vos pièces sur la communication avec les animaux ou « Trying Animal on Me » en 1996…
En 2005, pour l’exposition « Bêtes et hommes » à la réouverture de la Grande Halle de la Villette, à Paris, nous avions conçu une série de prothèses pour communiquer avec certaines espèces animales. L’une de nos créations permettait d’évoluer avec la démarche d’un chat… Dans cette nouvelle œuvre, il s’agit moins d’explorer la communication que de se focaliser sur le ressenti. Lors de l’injection de l’immunoglobuline dite neuro-endocrine, c’est-à-dire celle qui gère par exemple la thyroïde, je n’ai pas dormi pendant une semaine, trop énervée. J’ai expérimenté et ressenti dans mon corps la nature très vive du cheval. Une nature différente, étrangère à celle de l’homme. Dans ce projet, il s’agit de comprendre quel est le ressenti animal dans l’homme. C’est une expérience assez différente de celle qui consiste à prendre un organe d’un animal pour le greffer sur l’homme comme dans le cas des xénogreffes. L’animal n’est pas utilisé comme remplacement, mais comme point de départ pour comprendre de l’intérieur, dans notre corps humain, la réactivité animale. En cela, il est différent de notre projet tatouage « Trying Animal on Me ». A l’époque, on voulait tatouer toutes les espèces en voie de disparition. Très vite, nous nous sommes rendus compte que nous serions recouvert de tous les animaux. Quelque part, ça ne ressemblerait à rien ou simplement à quelque chose de monstrueux…
Ce nouveau projet rappelle plus nos premières « Cultures de peaux ». Leur réussite dépendait d’une chose : en adhérant à certains groupes anti-vivisection, nous avions accès directement aux laboratoires de culture. Lorsque les laboratoires cherchent des volontaires pour remplacer les animaux cobayes, ils les recrutent dans de tels groupes. Ces œuvres proposaient que l’animal ne soit plus au service de l’homme. Nous avons offert notre peau à la place de celles des animaux !
La plupart de vos œuvres traduisent un engagement politique. Que gagnent les artistes à entrer dans les laboratoires ?
Notre art est avant tout un art politique qui formule des opinions. Lorsque nous abordons les questions du bio-art, il nous paraît important que nous puissions les expérimenter sur et par nous-mêmes. Le bio-art nécessite d’être acteur, de prêter son corps, de s’impliquer… Même si c’est parfois impossible. Actuellement, nos recherches portent sur les organismes génétiquement modifiés. Malheureusement, comme le brevet n’est pas encore déposé (nous collaborons avec les chercheurs de l’INRA (l’Institut national de la recherche agronomique, ndlr) dans le domaine « plante », il sera finalisé dans un an ou deux), nous ne pouvons guère en préciser l’avancée. Cet OGM expérimental en soi inoffensif sera dangereux dans sa symbolique. S’il se répandait dans la nature, il en modifierait l’ordre. Il ne faut absolument pas qu’il se propage. Même si cette œuvre végétale demeure très visuelle, elle servira à une prise de conscience. A l’heure actuelle, personne, mis à part quelques spécialistes, ne peut discerner un champ de blé transgénique d’un autre champ de blé. Quelque part, nous cherchons à montrer une réalité parallèle dont on ne peut encore cerner les conséquences tant sur l’environnement que sur l’humain. Cette œuvre rejoint aussi les préoccupations que nous abordions dans nos « Cultures de peaux ». Nous voulions montrer les avancées scientifiques (xénogreffes, etc.) qui modifiaient l’homme pour que celles-ci soient moins abstraites pour le grand public.
Comment établissez-vous la disctinction entre expérience et œuvres, comme vos sculptures présentées à la galerie Anton Weller à Paris au printemps 2008 ?
Les expériences amènent à la production d’objets, mais elles sont également des objets artistiques en soi. Notre intérêt se porte sur le ou les processus de création, que ce soit dans nos sculptures, nos actions, nos photographies, nos vidéos, nos objets fonctionnels… Vivre un processus sur le terrain puis trouver les moyens d’en rendre compte, de lui donner un sens, de le partager avec le public, voilà ce qui nous motive véritablement.
Par exemple, l’agneau transpercé intitulé « Le Tout Autre » réinterprète l’Agneau mystique des frères Van Eyck (1432). C’est la première œuvre qui m’a fortement émue dans mon enfance et m’a influencée pour devenir artiste. Il y avait une cohérence à dénoncer l’utilisation sociale de l’animal comme un bouc émissaire, qui subit toutes les souffrances sans que l’homme s’y montre particulièrement sensible. Pour la « Machine à méditer sur le sort des oiseaux migrateurs », une chaise de repos qui referme ses ailes sur vous et joue sur une dialectique entre le confort du repos et l’inquiétude, c’est un processus de fabrication étroitement lié aux événements médiatiques autour de la grippe aviaire et du virus H5N1.
Je suis originaire de l’Ain, la région française où l’on a localisé les premiers cas dans l’Hexagone. Par mesure de sécurité, les autorités ont interdit aux gens de ramasser des plumes, puis de laisser leurs oiseaux dehors. Tout à coup, les oiseaux migrateurs annonçant joyeusement l’arrivée du printemps se transformaient en une chose effrayante et terrifiante. C’est une mutation du monde, un renversement de la perception. Sur place, nous avons ramassé avec précaution plusieurs plumes sans savoir si elles étaient infectées ou non. Puis nous les avons collées ensemble pour fabriquer des ailes au fauteuil. Bien entendu, les virus meurent, donc il n’y avait plus de risque.
|
recueilli par cyril thomas
|
|
 |