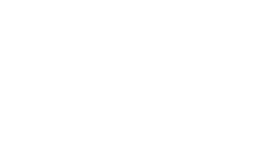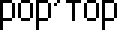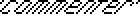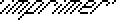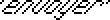« "Industrial society and it’s future", Unabomber’s cabin, Montana, 1996 », par Matt O’Dell, la maquette de la cabane d’Unabomber, le terroriste le plus redouté des Etats-Unis après Ben Laden. © DR
< 27'07'07 >
Epatantes galeries
« Vidéo et après » propose de faire découvrir des œuvres vidéo nouvellement acquises, des œuvres rarement présentées au public ou des œuvres historiques, en présence des artistes et/ou d’historiens de l’art contemporain, critiques, etc.
Les programmations sont orientées selon différents axes : des séances thématiques confrontant diverses démarches artistiques, des monographies d’artistes, ou encore des séances en lien avec l’actualité culturelle (exposition, festival, etc.)
Sonia Khurana, l’art indien sans les clichés
Dans l’une de ses vidéos-performances, intitulée Bird qu’elle avait réalisée à la fin de son cursus d’études au Royal College of Art à Londres, Sonia Khurana, toute nue, faisait l’oiseau. Elle montait sur un socle, essayait de se tenir sur la pointe des pieds, se lançait et se ramassait par terre, roulait boulait et recommençait. La vidéo est à Paris, des photos en sont tirées, le tout est exposé aujourd’hui à la galerie Jousse. C’est à la fois très drôle, très osé, très merveilleux et dérisoire. Sonia Khurana n’incarne aucune image attendue de la femme indienne. Elle a, comme elle le dit très simplement, un pied à New Delhi, d’où elle vient et où elle habite souvent et un pied à l’Ouest ; elle fut également résidente à la Rijks Akademie d’Amsterdam et circule en Europe.
Une autre vidéo est exposée, qui la dévisage de très près, alors que sa tête ensommeillée et enrhumée émerge à peine des couvertures, relâchée dans un demi-sommeil, dans une demi-conversation avec un homme qu’on ne voit pas, dans cet entre-deux endormi où la conscience s’évade et la relation se relâche. « Tu es bien ? Oui, et toi ? Je suis calme. Et toi ? ». Sonia Khurana nous confronte avec un événement au présent, sans avant, ni après, sans arrières. Non loin de l’écran, une série de photos montre le visage couché d’un homme noir, très beau, dans une position, qui, comme l’oiseau tendu sur son socle, n’est pas sans références à la sculpture de Brancusi. Ce visage d’homme très beau, on le retrouve dans une dernière image.
Matt O’Dell vole au-dessus d’un nid de complots
On l’avait repéré avec ses installations revisitant les catastrophes de l’histoire récente, comme ces débris à terre simplement intitulés « Columbia Space Shuttle, vol STS-107, 16 janvier 2003 ». Le Britannique né en 1976 sort de l’examen purement clinique pour ajouter à ses nouvelles installations une dimension presque mystique. Dans New Worship, c’est toute la parano mondiale qu’il examine et revisite à sa sauce, des adeptes de sectes aux amateurs des rumeurs les plus dingues. Ainsi, tout le monde sait qu’en observant attentivement le plan de la Maison blanche, on repère un hibou…
Matt O’Dell ne fait que « révéler » les preuves agitées par les adeptes du complot mondial à l’aide de cartes postales ou de dessins chiffonnés. La pièce la plus intéressante de l’exposition à la galerie Schleicher-Lange n’est pas la plus impressionnante : il s’agit d’une minuscule cabane en bois posée sur un piédestal et dans laquelle un mélange de vidéo et de bric à brac intrigue. Et puis cette voix de synthèse qui profère son texte en anglais, « la Société industrielle et son avenir », écrit par Théodore Kaszinski aka Unabomber. « "Industrial society and it’s future", Unabomber’s cabin, Montana, 1996 » reprend le principe du titre clinique, en référence directe au mathématicien devenu terroriste et traqué dans sa cabane au Montana en 1996. En ne présentant qu’une reproduction du réel, Matt O’Dell pousse à revisiter l’histoire récente. Mais pas dans le sens des paranoïas ambiantes (on nous cache tout-on nous dit rien). C’est bien plutôt en présentant cet « état des lieux » qu’il épuise la théorie du complot : même en regardant cette réalité encore et encore, le mystère de la dérive du scientifique reste entier.
Geneviève Gauckler et Stefano Pedrini, dessins pour rire
« Autour du monde », titre de son exposition à la galerie Sara Guedj, synthétise la façon de faire de la graphiste la plus repérée du moment, qu’on hésite à présenter encore : ses collages numériques ont marqué les pochettes d’albums de Björk, Dimitri from Paris ou Brigitte Fontaine et ses bonshommes patates animé quelques clips (notamment au sein du collectif Pleix), ses illustrations égayé Colette et autres Libé, voire, si certains s’en souviennent, accompagné l’essor de la nouvelle économie la plus dingue (boo.com était designée par elle). Aujourd’hui, son « voyage autour du monde » est un mix furieux de collages saturés d’images de bouffe, de tours et d’éléments archétypiques des cultures nationales (la 2CV pour la France, les spaghettis pour l’Italie…). On se lasserait presque de ses raccourcis graphiques et photo survitaminés, pour préférer une illustration plus sobre (avec toujours la même pointe d’humour). « White Stripe » figure un bonhomme patate lilliputien qui fait littéralement tache sur une bande à six couleurs et fond jaune vif.
Surtout, l’accumulation ébouriffée de ses collages et dessins dans le tout petit espace de la nouvelle galerie de la rue Louise Weiss ne parvient pas (et c’est heureux) à faire de l’ombre à l’autre invité de cette exposition inaugurale, Stefano Pedrini, artiste italien vivant à Berlin et dont on découvre avec intérêt la créativité discursive. Avec ses peintures directement inspirées du graffiti, « Life is a brain condition » est conçu comme un labyrinthe ludique, où les signes débordent du cadre des peintures pour squatter les murs et le plafond, où la tranche du cadre est aussi un élément à occuper, et où l’écriture s’avère du latin. Pour mieux contraster avec l’esthétique cartoon des dessins.
|
elisabeth lebovici et annick rivoire
|
|
 |