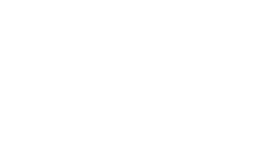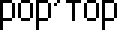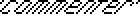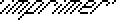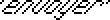Jean-Claude Van Damme dans "Chasse à l’homme" de John Woo, archétype du genre dont causera le philosophe Grégoire Chamayou à "Il faut qu’on parle", le 15/01 à la Cantine. © DR
< 14'01'13 >
Il faut qu’on parle, le salon littéraire... de la Chasse à l’homme
Chasse au faciès, traque du pauvre et des sans papier… Les 1001 manières d’envisager la chasse à l’homme sont au cœur de la deuxième session d’« Il faut qu’on parle » (IFKP), soirées littéraires entre open micro et stand up textuel pointu, organisées notamment par les auteurs Wendy Delorme et Isabelle Sorente (et dont Poptronics est partenaire), ce mardi 15 janvier à la Cantine. Au programme de cette expérience littéraire live, un philosophe, un slameur, une essayiste, une écrivain et même un économiste atterré : Grégoire Chamayou (philosophe), Benjamin Coriat (économiste atterré), Wendy Delorme (écrivaine), Julien Goetz (auteur et acteur), Abd El Haq (slameur), Anne Horel (artiste et compositrice), Felix Jousserand (slameur), Ruwen Ogien (philosophe), Peggy Sastre (essayiste), Isabelle Sorente (romancière et essayiste) liront leurs textes (pour certains inédits), puis laisseront le micro ouvert pour l’intervention impromptue de qui veut (inscription préalable par mail ilfautquonparlenow@gmail.com).
On vous avait raconté la rare qualité aussi bien d’écoute que de contenus de la première édition de ce salon littéraire à la sauce participative. Pour vous mettre en bouche, voici en avant-première deux textes du programme de cette deuxième édition, celui de Grégoire Chamayou, à l’origine de la thématique du soir, et celui de Peggy Sastre, qui nous enchante encore avec sa façon de dire la domination masculine en allant chercher là où le féminisme n’est pas encore allé. Bonne lecture !
Chasses à l’homme, par Grégoire Chamayou
Grégoire Chamayou est chercheur en philosophie au CNRS, dans l’équipe CERPHI à l’ENS-LSH. Il a publié, à La fabrique, « Les chasses à l’homme » (2010) et aux editions La Découverte, « Les corps vils » (2008). Ce texte est extrait des Chasses à l’homme.
Téléchargez le texte au format PDF :
« A quelques pas de là, je reconnus immobile et couché à plat ventre, un jeune soldat ordinairement d’une nature douce et inoffensive. Son humeur en rapport avec son apparence physique, eût répugné à verser le sang d’un mouton. Mais la chasse à l’homme l’avait transfiguré. La tête couverte de feuillage, le menton au ras de terre, il s’était traîné là en rampant, et, les yeux obstinément fixés sur un point unique du marécage, il guettait comme un animal carnassier une proie invisible. » (1) Si la proie humaine est animalisée, le chasseur l’est donc aussi, en ce qu’il éprouve des affects très animaux, des affects de prédateur. Ceux qui goûtent aux joies cruelles de la chasse à l’homme se transforment et s’ensauvagent. Dans le contexte colonial, c’est le thème critique, cher à Césaire, de la bestialisation ou de l’ensauvagement des maîtres : « La colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l’abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis » (2).
Pour l’esclave fugitif, l’expérience de la traque produit d’autres effets de conscience. En s’échappant, il a certes reconquis sa liberté de mouvement, mais il se sait encore poursuivi. Sa nouvelle vie est celle une existence traquée. Cela constitue encore, à distance, une forme spécifique d’assujettissement. La proie est l’objet d’une traque. Pour parvenir à son entière libération, elle devra reconquérir sa subjectivité depuis cette position d’objet. Mais comment un tel renversement est-il possible ?
Dans la « Critique de la raison dialectique », Sartre explique que « l’individu qui se trouve traqué dans le champ pratique par un groupe qui s’organise pour la chasse à l’homme (...) ne peut tenter de s’évader du cercle que s’il parvient à réintérioriser son objectivité pour le groupe, c’est-à-dire à déchiffrer ses propres conduites à partir de la liberté commune de l’adversaire : cet acte que je vais faire, c’est justement celui qu’ils attendent de l’objet que je suis pour eux » (3).
Pour pouvoir anticiper les réactions de ses poursuivants, l’homme traqué doit apprendre à lire ses propres actions avec les yeux de son prédateur. Cette intériorisation du regard de l’autre lui fait développer une prudence extrême, qui prend d’abord la forme d’une inquiétude paralysante, d’ordre paranoïaque : se voir en troisième personne, se demander, à chacun de ses actes quel usage pourra en être fait contre soi-même.
Mais cette angoisse peut ensuite se muer en raisonnement. La chasse mobilise en effet une forme particulière de pensée : une aptitude mentale qui, comme l’explique Hobbes, à partir d’un désir d’un objet, « fait penser au moyen prochain de l’atteindre, et ce dernier à un autre moyen prochain, etc. (...) ce que les Latins appellent sagacité et que nous pouvons appeler chasse ou poursuite : ainsi les chiens poursuivent les bêtes à l’odeur, les hommes les chassent à la trace » (4). Le problème de la proie est qu’elle laisse des traces qui permettront de remonter jusqu’à elle. La fuite, le moyen d’échapper, devient aussi, dans un cercle tragique, le moyen d’être retrouvé. Mais le fugitif peut anticiper sur la sagacité de ses poursuivants et brouiller les pistes. L’art de la fuite est un art sémiotique, un art de la maîtrise des traces. Dans sa fuite, l’esclave américain Henry Bibb, croise, en face de lui sur la route, un groupe d’hommes blancs à cheval. Ils le dépassent, sans rien laisser paraître, mais le fuyard interprète cette indifférence comme une ruse et les soupçonne d’être en réalité allé chercher des chiens de chasse à la ferme voisine. Ils vont donc revenir à l’endroit où ils l’ont croisé et lâcher les chiens sur les bas-côtés pour retrouver sa piste : « Je pensais que les chances de m’échapper seraient plus grandes si je rebroussais chemin en prenant la route par où ils étaient arrivés, dans le but de les tromper, car je supposais qu’ils ne pourraient soupçonner que je prenne la même direction qu’eux dans le but de leur échapper » (5). Revenir sur ses pas et faire un saut de côté pour leurrer la meute, c’est ce que, dans le vocabulaire de la chasse, on appelle faire hourvari : « Le cerf, le chevreuil, le lièvre, etc., a fait un hourvari lorsque, pour embarrasser les chiens et les faire tomber à bout de voie, il s’en retourne par où il est venu » (6). Ce stratagème engage ce que Sartre appelait un « dialogue au sens d’antagonisme rationnel » entre l’homme traqué et ses poursuivants, au sens où l’action intègre alors à sa formulation en tant que projet stratégique les réactions probables de la volonté adverse qu’elle cherche à contrer.
Ce faisant, la proie échappe à l’état d’objectivation simple qui était son point de départ. En intégrant à son plan d’action la logique de son prédateur, elle l’enveloppe et l’intériorise. Elle acquiert ainsi, à l’issue de cette première dialectique de la traque, les capacités mentales d’un chasseur alors qu’elle n’est encore que proie. Si cette nouvelle aptitude stratégique ne lui permet encore, dans un premier temps, que de déjouer les intentions de ses poursuivants, elle le rend bientôt capable de tout autre chose. L’art de la fuite efficace, en ce qu’il suppose la maîtrise intellectuelle de la logique cynégétique, prépare un retournement de la relation de chasse. D’objet traqué, la proie peut se faire sujet, c’est-à-dire, dans un premier temps, chasseur à son tour.
En 1833, les autorités de l’île Bourbon mirent à prix la tête d’un marron dénommé Charles Panon. En vain. Plusieurs semaines plus tard, un agent de police qui conduisait à la prison un convoi de marrons fut attaqué sur la route : « C’est dans cette lutte que cet agent ayant été pris aux parties génitales fut bientôt renversé et qu’il n’eut que le temps d’appeler du secours en criant à l’assassin (…) Charles Panon, dont l’audace s’accroît de jour en jour paraît être le principal auteur de ce délit. » (7) Qui traque les hommes comme des bêtes féroces peut s’attendre à leurs morsures.
Mais le marronnage pouvait aussi, gagnant en intensité, prendre une dimension plus menaçante et plus politique encore. Les quilombos où se regroupaient les marrons se mettaient parfois à fonctionner comme les bases arrière d’une guérilla.
Aux Antilles, des expéditions armées furent lancées contre les regroupements d’esclaves fugitifs réfugiés dans les bois, foyers d’insurrection potentiels menaçant la domination coloniale. De façon significative, ces opérations militaires continuaient à s’organiser et à se penser dans les formes de la chasse. Lorsque les Marrons de Trelawney se révoltèrent en 1796 à la Jamaïque, l’Assemblée des colons résolut de faire venir de Cuba des meutes de chiens dressés à la chasse aux esclaves fugitifs. Anticipant les « calomnies » qui ne manqueraient pas de se formuler en métropole une fois la nouvelle connue, les planteurs cherchèrent des justifications dans la philosophie morale et dans l’histoire de la guerre, avec, comme l’écrit Humboldt, « tout le luxe d’une érudition philologique » (8). Ils firent ainsi valoir que « les Asiatiques de tout temps ont mené les éléphants à la guerre » (9) et que si l’emploi d’animaux contrevenait au droit de la guerre, il faudrait sans doute interdire aussi l’usage de la cavalerie. De toutes les manières, on était en guerre, contre un ennemi dangereux, et la sécurité des Blancs sanctionnait tout. Forts de ces arguments, les autorités firent venir de Cuba, le 15 décembre 1796, une troupe de « chasseurs Espagnols, presque tous hommes de couleur et une meute d’une centaine de chiens » (10). On raconte qu’épouvantés par cette nouvelle, les révoltés capitulèrent. Le recours aux chiens ne s’expliquait pas seulement par les exigences tactiques d’une guerre de guérilla menée contre un ennemi insaisissable, dont il s’agissait avant tout de retrouver la trace. C’était aussi affaire de catégories mentales. Recourir à des limiers était un puissant moyen psychique de reconduire et de réimposer l’écart ontologique absolu que l’insurrection avait mis à mal entre les maîtres et leurs esclaves.
Dans cette forme de guérilla des dominants contre les dominés, l’usage des chiens exprimait encore un déni de la situation de combat. Traiter la guerre civile comme une opération de chasse à l’homme, c’est persister à nier l’événement qui se produit, refuser de reconnaître ce fait que les dominés sont parvenus à imposer une situation d’antagonisme où l’on entrevoit la possibilité d’un renversement du rapport de force, et non plus un simple trouble à l’ordre public. Dans ce type de situation, la chasse à l’homme devient alors le moyen d’une guerre cynégétique –forme de guerre qui présente les caractéristiques suivantes : 1° elle ne prend pas la forme d’un affrontement, mais d’une traque ; 2° le rapport de forces est marqué par une radicale dissymétrie des armes ; 3° Sa structure n’est pas celle d’un duel : un tiers terme est mobilisé comme médiation ; 4° on ne reconnaît pas l’ennemi en tant qu’ennemi, c’est-à-dire en tant qu’égal –ce n’est qu’une proie ; 5° on fait usage de moyens non-nobles, relevant de la police ou de la chasse plutôt que du registre militaire classique. À noter que ce travestissement de la guerre civile en opération de chasse produit immanquablement un effet de burlesque, qui, dans une veine macabre, devient le trait caractéristique de tous les récits de guerre cynégétique. Le burlesque cynégétique naît du contraste entre la bassesse des moyens employés et la grandeur du style dont on les pare. Signe des temps, les seuls motifs héroïques dont les colons semblent alors encore disposer pour orner les récits sont les faits d’armes de leurs chiens (11).
Lors de la révolte de Saint Domingue, en 1802, l’armée française recourut au même expédient que les colons de la Jamaïque, mais avec un tout autre dénouement. Dans le but de réprimer l’insurrection des Marrons, les autorités achetèrent à Cuba plusieurs centaines de dogues espagnols, des chiens bloodhounds « dressés à la chasse aux nègres et aux Indiens (…) M. de Noailles, qui avait ramené ces féroces animaux, en obtint le commandement en chef ; il devint ainsi le Général des chiens. » (12) Dans une lettre annonçant l’arrivée sur le terrain de vingt-huit chiens bouledogues, Rochambeau, général de Napoléon Bonaparte, avait écrit, afin d’expliquer le fait qu’aucune dépense n’était prévue au budget pour leur alimentation : « Vous devez leur donner des nègres à manger. Je vous salue affectueusement. Signé : Rochambeau. » (13) Les opérations s’engagèrent, mais les marrons opposèrent une résistance imprévue. Acculées à chercher refuge au Cap, les troupes françaises se trouvèrent coupées de leur approvisionnement en nourriture : « Les assiégés eurent pour dernière ressource les chiens de guerre qu’ils avaient nourris de la chair des nègres. Les chasseurs d’hommes furent obligés de manger leurs meutes. » (14)
Le propre de la chasse à l’homme, qui en fait le danger mais aussi l’attrait aristocratique suprême, c’est la possibilité, toujours présente, d’un retournement de la relation : que la proie devienne prédateur, que le chassé devienne chasseur. La chasse à l’homme est marquée par cette instabilité fondamentale : lorsque la proie se refuse de continuer à l’être, et que, cessant de fuir, elle réplique et traque à son tour, la chasse devient un combat ou une lutte. La relation de chasse et de prédation, appliquée à des hommes par des hommes a ceci de spécifique que la proie peut apprendre, qu’elle n’est évidemment pas proie par nature, et que - comme les maîtres peuvent en faire l’amère expérience - les dominés peuvent développer des savoirs qui ne sont pas le privilège des maîtres : devenir chasseurs ou stratèges à leur tour.
Ce renversement des positions est du reste le motif classique de tous les récits, le ressort scénaristique de tous les films de chasse à l’homme : le gibier devient chasseur et le chasseur proie. C’est pour cette raison que la chasse à l’homme est le « jeu le plus dangereux », comme l’indique le titre original du film « La chasse du comte Zaroff », « The most dangerous game » (15). Les chasseurs d’hommes d’hier et d’aujourd’hui feraient sans doute bien de méditer cette leçon que tous les récits, anciens ou modernes attestent : le chasseur sera chassé, son arme prise et tenue à son autre extrémité par son ancienne proie, qui esquissera peut-être un sourire au moment de porter le coup fatal. Avant de quitter la scène dans une dernière explosion, les anciens chasseurs, défaits, auront peut-être le temps de faire cette ultime demande : « Mais pourquoi fais-tu cela ? » Et l’ancienne proie de répondre, à l’instar du personnage de Jean-Claude Van Damme dans « Chasse à l’homme » de John Woo : « C’est que les pauvres aussi ont besoin de distractions ».
(1) Ibid.
(2) Aimé Césaire, « Discours sur le colonialisme », Présence Africaine, Paris, 1989, p. 11.
(3) Jean-Paul Sartre, « Critique de la raison dialectique », Gallimard, Paris, 1960, p. 515.
(4) Hobbes, De la nature humaine, Vrin, Paris, 1991, p. 45.
(5) William L. Andrews, Henry Louis Gates, op. cit., p.533.
(6) Jean Baptiste Le Verrier de La Conterie, « L’école de la chasse aux chiens courants ou Vénerie normande », Bouchard-Huzard, Paris, 1845, p. 463.
(7) Prosper Ève, « Les esclaves de Bourbon : la mer et la montagne », Karthala, Paris, 2003, p. 224.
(8) Alexander von Humboldt, « Examen critique de l’histoire de la géographie du nouveau continent », Paris, Gide, 1837, Tome III, p. 374.
(9) Bryan Edwards, « Histoire abrégée des nègres-marrons de la Jamaïque », cité par la Bibliothèque britannique, Imprimerie de la bibliothèque britannique, Genève, 1804, Tome XXVI, p. 39.
(10) Ibid., p. 49.
(11) Au XIXe siècle, dans un autre contexte, les lecteurs français pouvaient ainsi s’extasier sur les exploits de la brigade canine employée contre les Indigènes en Algérie : « J’ai connu l’illustre Blanchette, l’Attila du Kabyle, la plus noble expression de la bravoure canine, une grande levrette blanche qui ne marchait plus que sur trois pattes, ayant oublié la quatrième dans une lutte corps à corps avec un chef ennemi. » Alphonse Toussenel, L’esprit des bêtes : vénerie française et zoologie passionnelle, Librairie sociétaire, Paris, 1847, p. 169.
(12) Charles Expilly, « La traite, l’émigration et la colonisation au Brésil », Lacroix, Paris, 1865, p. 212.
(13) « Mémoire autographe du général Ramel sur l’expédition de Saint-Domingue », cité par Victor Schoelcher, « Vie de Toussaint Louverture », Karthala, Paris, 1982, p. 373.
(14) Elias Regnault, op. cit., p.69.
(15) Le film fut réalisé en 1932 à la R.K.O. par Irving Pichel et Ernest B. Schoedsack d’après la nouvelle éponyme de Richard Connell. Le titre joue sur le double sens de « game » en anglais, à la fois jeu et gibier.
///////////////////////
« Hommes en voie de disparition, femmes en voie d’émancipation », par Peggy Sastre
Auteur et essayiste, Peggy Sastre travaille le féminisme en creusant du côté de la domination masculine. On peut retrouver ses textes sur le site Nihil ex nihilo. Ce texte-ci a été écrit pour la deuxième d’Il faut qu’on parle.
Téléchargez le texte en PDF
A cette époque-là, les femmes commençaient à prendre leur indépendance. Après avoir subi, pendant des centaines d’années, le plus pur cantonnement aux travaux domestiques, elles sortirent peu à peu de chez elles. Elles se mirent à exercer des métiers rémunérés, à gravir les échelons sociaux. Bientôt, on vit des femmes diriger leurs propres commerces, leurs propres entreprises, certains syndicats étaient même quasi exclusivement féminins...
Vous voyez de quoi je veux parler ? Nous sommes en Europe, oui, mais à une époque bien plus ancienne que ces cinquante voire ces cent dernières années.
En fait, ce genre d’émancipation féminine est typique d’une ville médiévale, entre 1300 et 1500.
Le genre de ville où naquit, par exemple, Christine de Pizan : la première femme poète et écrivain de l’histoire à vivre de sa plume. Amatrice des sujets les plus divers (morale, politique, philosophie ou même stratégie militaire), elle se lamentait (1) de son éducation trop traditionnelle
(la citation originale est en ancien français, j’ai donc un peu modifié le texte pour que tout le monde comprenne) :
« Ton père grammairien et philosophe, ne pensait pas que les femmes ne valaient rien en sciences, mais ton goût pour les lettres lui faisait grand plaisir à voir. Par contre, l’opinion de ta mère, qui voulait t’occuper de filasses selon l’usage commun des femmes, t’empêcha dans ton enfance d’être poussée plus loin et plus à fond dans les sciences. »
C’est aussi à cette époque-là que se formèrent les premières communautés de Béguines, des moniales libérées de toute hiérarchie ecclésiastique, n’appartenant à aucun ordre religieux établi, ne prêtant aucun vœu de chasteté trop strict et vivant dans un système ouvert au monde et autogéré qui, pour certains spécialistes, relève d’une « démocratie avant l’heure ».
Mais qu’avait-elle de si spécial, cette époque, pour que les femmes se sentent si attirées par l’indépendance ?
Pas vraiment d’initiatives archéo-féministes notables, pas d’amélioration formelle de l’éducation ni de la prospérité, pas non plus de meilleures conditions de vie...
Aucun mouvement social, comme on l’entend aujourd’hui, ne peut être impliqué dans cette marche vers l’autonomie féminine. Tant et si bien qu’à peine un siècle plus tard, il n’y paraissait plus : les femmes dirigeant des fabriques, des boutiques ou des guildes se comptaient sur les doigts d’une main et les congrégations féminines un peu trop remuantes avaient été persécutées et remises dans le droit chemin par les autorités religieuses.
Que s’était-il donc passé ?
L’explication serait à chercher (2) du côté de la démographie et plus particulièrement d’un sexe-ratio – soit le nombre d’hommes par rapport à celui des femmes dans une population – déséquilibré en faveur de ces dernières. En bref, avec moins d’hommes dans les parages, et donc moins de possibilités de se faire entretenir, les femmes auraient été poussées vers l’autonomie...
Chez les animaux non humains, les effets d’un trop plein de femelles ou d’un trop plein de mâles dans une population donnée sont bien connus. La problématique est aussi idiote que le sont l’offre et la demande : un sexe qui se fait rare, c’est un sexe qui se fait cher.
Dans notre belle espèce, le sex-ratio n’est pas non plus sans effet sur certains schémas conjugaux, familiaux et même financiers. Sans parler des conséquences sociales des avortements sélectifs et autres infanticides de filles dans certains pays (dans certaines régions indiennes, on compte plus de 800 hommes pour 100 femmes, alors qu’un sexe ratio typique oscille entre 100 et 110 hommes pour 100 femmes).
L’été dernier, une étude menée par des chercheurs hollandais et américains en psychologie et en sciences économiques (3) partait de cette hypothèse : parce que l’évolution a poussé les femmes à préférer la protection des hommes à leur autonomie, un sexe-ratio défavorable aux hommes poussera les femmes à faire passer leur carrière avant leur famille ; quand il y a pénurie de bons partis potentiels, mieux vaut oublier la chasse à l’homme et chercher à subvenir soi-même à ses besoins. Et pour vérifier leurs conjectures, ils ont procédé à quatre petites expériences que je vous résume rapidement.
1. Dans la première, ils se sont plongés dans les archives (4) du Bureau du recensement et du Département du travail américains, histoire d’isoler suffisamment de données démographiques et économiques pertinentes : sexe-ratio dit « opérationnel » (entre 15 à 44 ans, soit la fenêtre reproductive féminine moyenne), nombre d’enfants, âge de la première maternité ou encore métiers les plus rémunérateurs pour les femmes. Résultat : plus le sexe-ratio est défavorable aux hommes, plus les femmes optaient pour des carrières lucratives. Par ailleurs, ce même type de sexe-ratio est corrélé à des grossesses moins nombreuses et plus tardives : quand les hommes se font rares, les femmes font moins d’enfants et, quand elles en font, elles les font à un âge plus avancé.
2. Ensuite, les chercheurs ont montré plusieurs séries de photographies – où les hommes étaient en surnombre, où les femmes étaient en surnombre, où les deux sexes étaient numériquement à égalité – à une petite centaine de jeunes femmes, interrogées ensuite sur leurs futures préférences familiales et professionnelles. Résultat : quand les hommes étaient moins nombreux que les femmes sur les photos, les participantes avaient davantage tendance à faire de leur carrière une priorité.
3. Lors de la troisième expérience, les chercheurs jouèrent encore sur la perception qu’avaient leurs cobayes de la proportion de femmes et d’hommes d’un environnement donné (ici, par des textes écrits), mais ils évaluèrent aussi leur perception du marché du travail et du marché sexuel et sentimental – et ce afin de vérifier que l’influence d’un défaut relatif d’hommes sur les préférences professionnelles est bien liée à des problématiques conjugales et reproductives, et non pas tout simplement au fait que moins d’hommes signifie davantage de postes à forte rémunération disponibles. Résultat : une lacune en hommes induit augmente le carriérisme des femmes, mais aussi leur sentiment qu’elles auront du mal à se caser. Par contre, les scientifiques n’ont noté aucun effet de la densité masculine sur l’impression de difficulté ou de facilité à se trouver un travail, ce qui montre bien que, si les femmes préfèrent atteindre des postes importants quand les hommes se font rares, c’est parce que leurs débouchés conjugaux sont compromis, et pas parce qu’elles estiment avoir davantage leurs chances de rayer le plafond de verre.
4. Enfin, les chercheurs ont ajouté une dimension supplémentaire au bouzin, qui, je résume, veut que les femmes soignent leurs perspectives professionnelles quand les perspectives de bons partis s’amenuisent. Mais qu’en est-il de celles qui ont une bonne longueur d’avance dans la chasse au mari, à savoir les grosses bonnasses ? Subissent-elles, comme les autres, les effets d’un sexe-ratio déséquilibré, ou restent-elles assises sur leurs acquis physiques ? Les chercheurs ont donc soumis leurs participantes au même genre de protocole que précédemment, mais en mesurant leur degré de beauté. Résultat : non seulement les femmes préfèrent leur carrière en cas de pénurie masculine, mais elles la préfèrent d’autant plus qu’elles ne sont pas attirantes.
Sur ce, je vous laisse deviner quel type de sexe-ratio connaissent aujourd’hui les pays occidentaux...
(1) Dans son ouvrage le plus célèbre, « La cité des Dames ».
(2) cf. les sociologues Marcia Guttentag et Paul Secord, auteurs de « Too many women ? – the sex ratio question », Trop de femmes ? La question du sexe-ratio, publié pour la première fois en 1983.
(3) Dirigée par Kristina Durante, intitulée « Sex ratio and women’s career choice : does a scarcity of men lead women to choose briefcase over baby ? » (le sexe-ratio et le choix de carrière des femmes : un manque d’hommes pousse-t-il les femmes à préférer l’attaché-case au bébé ?), elle confirme expérimentalement et avec des femmes de notre époque les analyses socio-historiques de Guttentag et Secord.
(4) 2009.
 |