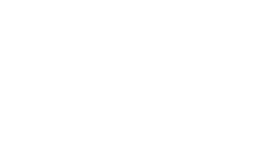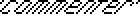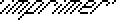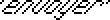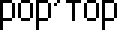
Catalogue de la biennale (28 euros).
Vente de produits dérivés signés des graphistes M/M.

(Lyon, envoyée spéciale)
« Moi, je suis la dernière à qui j’ai parlé. »
(Une dame, s’exprimant dans le tramway de Lyon, ligne 1 direction la Part-Dieu, mardi matin).
La Biennale de Lyon 2007 aimerait se présenter comme un jeu « dans lequel interviennent des JOUEURS (commissaires d’expositions, artistes, auteurs), auxquels il a été demandé de contribuer à définir cette décennie » (dixit le catalogue, CAPITALES incluses). Voilà l’idée, le concept, le pitch de la Biennale, que le maire de la ville, Gérard Collomb, s’excusait de ne point avoir vue lundi matin, en rappelant qu’il avait pourtant visité « celle de l’année dernière » (sic).
Cette règle du jeu n’a pas grand-chose pour surprendre : dans l’histoire de l’art, la métaphore du jeu, qu’il s’agisse des échecs, de la poupée, du « grand jeu » surréaliste, du jeu vidéo, du Lego ou du Monopoly, est souvent usitée, même pour caractériser des expositions ; ainsi le formidable historien d’art Hubert Damisch avait autrefois, à Rotterdam, traité des œuvres d’art canoniques comme des pièces sur un échiquier.
Qui va gagner des millions ?
A Lyon, cependant, avec ses « 60 JOUEURS du monde entier » et - complexité suprême, un « premier cercle », puis un « deuxième cercle » de joueurs ! - la devinette est à prendre au sens « gagneur » du terme. On l’associe aux innombrables parties de poker que suce et resuce aujourd’hui la télé. Dans le marché de l’art (très cher) anglo-saxon, on parle aussi de « players », ce qui veut dire « des mecs qui comptent », des gens de pouvoir qui ont le pouvoir et les moyens de faire parler, supposément décisionnaires décisifs. L’exposition s’engouffre ainsi dans la voie dictée par la success story de l’art contemporain. Qui va gagner des millions ? Celui, ou celle, qui aura la plus grosse stratégie.
Un exemple au hasard, celui de l’AUTEUR Eric Troncy, lequel présente David Hamilton, le photographe fameux des nymphettes 70’ s. Comme il l’avait fait naguère pour Bernard Buffet, Troncy « joue » sur l’effet de surprise : comment ? David, pas Richard Hamilton ? Le gars qui mouillait l’objectif pour embuer ses graciles modèles ? Après tout, banco : pourquoi ne pas « remettre » en selle celui qui servait de repoussoir à l’avant-garde bourgeoise des seventies. Le petit problème, c’est qu’on est en 2007 et que notre société sécuritaire oblige désormais à surligner ces bien anodines images pubères du sempiternel panneau : « peut choquer certains enfants ». Violà, pardon, voilà la valeur ajoutée de la stratégie : sa démonstration.
C’est quoi, une stratégie ? A Lyon, celle-ci s’opère dans la relation entre la puissance « invitante », celui où celle qui a choisi l’artiste (et qui apparaît en premier dans l’ordre des présentations) et, en second, « l’invité », le choisi en question. Un et un : l’artiste et son « curator », « l’artiste et son tuteur, l’autiste et son tutu », ironisait notre amie Francine, qui signait un bon mot. En effet, cette relation s’exprime à peu près ainsi : comment vais-je apparaître ? Comment se montrer, c’est-à-dire se faire voir (valoir) en regard des autres ? Dans un tel round « d’observation », on n’est pas dans le même registre que celui du regard esthétique, car ce qu’on examine est bien plutôt du côté du curateur. Il n’est pas anodin que les œuvres « à écran » (film, dvd, vidéo... ), nécessitant le noir et la projection, se préoccupent beaucoup cette année des sièges pour les spectateurs : amas de chaises, fauteuils « design », dispersion de sièges ou coussins baba-cool. C’est l’un des traits frappants des installations. On « se » regarde dans les yeux de « qui » vous regarde ?
L’individualisme artistique
Ce n’est pas qu’il n’y ait pas des bonnes pièces dans cette Biennale, ni que la disposition générale ne soit pas aisée et réussie. On a beaucoup aimé l’œuvre lauréate du « Lion dort en chocolat » : le bunker musicien jouant du trombone à coulisses (live) des formidables portoricains Jennifer Allora et Guillermo Calzadilla, par ailleurs déjà vu en d’autres occasions. On a adoré le bruit vertigineux d’un ascenseur fonçant, comme dans la mine d’où provient ce son, dans le noir total d’une installation de James Webb ; dans le même genre secouant, le corridor aux lumières épileptiques et les effigies lumineuses ou drapeaux français corrodés du collectif Claire Fontaine, sont très efficaces. Les petits films qui s’enchaînent sans lien aucun, œuvre de Seth Price, nous intéressent ; et le château hanté de Liu Wei, fait de fenêtres pékinoises (provenant de Pékin), révèle, dans son espace intérieur, du mobilier d’école perdu sous la poussière. Le gogo boy musclor qui se désappe entre une œuvre de Dan Flavin, une de Dan Graham et une de Larry Bell pour déclarer, en slip, le titre : « Selling Out » (tout vendu) de la pièce de Tino Sehgal a fière allure. Et enfin, l’hommage rendu à Patrice Joly, ancien animateur de la Zoo Galerie de Nantes et directeur de la revue gratuite O2, par Saadane Afif et tous ses amis artistes, est symptomatiquement l’endroit le plus bordélique et le plus passant de la Biennale : autrement dit, il s’agit d’une galerie d’art contemporain dans un musée…
Tout ça fait-il exposition ? Une exposition, c’est d’abord une articulation des œuvres entre elles, c’est ce qu’elles foutent ensemble, ou successivement, c’est aussi comment elles discutent. Une exposition, c’est aussi une histoire en commun, un truc que partagent des gens, une collectivité de gens, jusqu’au jour du vernissage et qu’ils partagent après avec une autre collectivité, les visiteurs ; c’est une production, au sens cinématographique du terme, qui n’est pas arrêtée au moment où elle se projette aux visiteurs. Ce dont la Biennale de Lyon fait montre, au contraire, c’est d’un individualisme poussé au maximum. L’artiste avec son tuteur, enfermés dans leur unité de lieu, leur unité de temps. Notre individualisme forcené sans doute : celui qui régit le monde dans lequel nous vivons. La Biennale en cela est un excellent reflet du monde. Mais les règles de l’art doivent elles forcément s’y conformer ? La compétition entre « JOUEURS », c’est à dire ceux qui aimeraient bien devenir « DÉCIDEURS » est-elle la seule et unique version du « travail de l’art » ?
Pourtant, le modèle d’exposition auquel la Biennale se réfère a déjà fait ses preuves. L’idée d’appeler ses copains, ses collègues pour qu’ils ou elles vous filent un coup de main en prenant chacun en main un bout d’exposition à sa charge est, a priori, sympathique. La fragmentation ou l’éparpillement qui en découlent peuvent avoir leurs avantages. Le pari était-il d’en faire le système assumé d’une Biennale ? D’autant qu’il se passe quelque chose de curieux, en fin de compte : cette Biennale qui se veut « contre » les autres, qui, en se donnant le cadre d’un jeu, veut en maximaliser les règles et faire éclater tout ce qui fait habituellement ciment, n’est finalement pas radicalement différente des autres.
En guise de contrepoint, il faut absolument aller voir, à l’Opéra, l’œuvre fa-bu-leuse de Jérome Bel, « The Show must go on » : tout en faisant partie de la Biennale de Lyon 2007, elle la détricote et en inverse le sens. Il ne s’agit là, que du collectif, de l’émotion du cliché et du regard partagé.
| elisabeth lebovici |
 |

Rencontre avec Asi Burak, l’ex-officier israélien devenu producteur de jeux vidéo pacifistes
Il est plus que temps d’« Exploser le plafond »
L’icône Susan Kare
A la Biennale de Lyon, l’art sans artefact

Art Orienté Objet : « J’ai ressenti dans mon corps la nature très vive du cheval »
Papillote infuse un brin de permaculture dans le jeu, l’art et les réseaux
Métavers, tout doit disparaître (et Hubs aussi)
David Guez « expérimente sans attendre » avec les éditions L