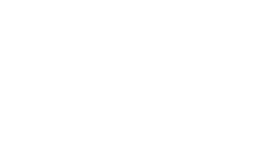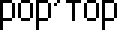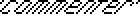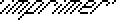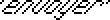Walden, Massachussets, où Henry David Thoreau installa sa cabane philosophale. © Pierre Nouvel
< 30'04'10 >
Ma cabane Walden, par Jean-François Peyret
« Matériau Thoreau » est la carte blanche de Jean-François Peyret, le metteur en scène passionné par la science, les défis posés à l’intelligence humaine par l’intelligence artificielle, pour la revue papier du Centre des écritures contemporaines et numériques (CECN) « Patch », parue en mars dernier. « Re:Walden », le nouveau projet du metteur en scène de « Tournant autour de Galilée », des « Variations Darwin » ou de « Turing Machine » tourne cette fois autour d’Henri Thoreau. L’auteur américain et père de la désobéissance civile avait écrit « Walden » en 1854 après sa retraite de deux ans dans une cabane au bord de l’étang de Walden (Massachusetts), à l’écart (mais pas trop) de ses concitoyens.
Paradoxalement, celui qui vit dans les bois et tente de réduire sa vie au strict nécessaire, est à l’exacte place pour interroger le rapport de l’homme à la technique. Réplique à celle de Thoreau, la « cabane » de Jean-François Peyret est élaborée en ce moment avec l’aide de l’architecte Jean Nouvel, du compositeur et bidouilleur de génie Thierry Coduys et de l’artiste Agnès de Cayeux (notamment) pour une installation-performance présentée au Fresnoy du 12 juin au 25 juillet prochain (Jean-Françis Peyret est l’un des artistes enseignants invités cette année au Studio national des arts contemporains). Poptronics, en partenariat avec Patch, reproduit ci-dessous le texte (formidable) du metteur en scène.
Matériau Thoreau, par Jean-François Peyret
1. Où la cigogne va chercher les enfants
Pourquoi ce fragment de « Minima Moralia » d’Adorno
me revient-il à l’esprit au moment d’expliquer comment
naît un spectacle ? Quelle cigogne a bien pu aller chercher
Thoreau dans sa forêt pour le déposer sur le plateau
de mon théâtre ? « Walden » avait été l’un des livres
de prédilection de ma jeunesse, mais elle est bien loin,
et, ces derniers temps, je séjournais du côté de Florence
chez Galilée plutôt que dans les forêts du Massachusetts.
J’étais tout à mon « démontage » de « La vie de Galilée », et
j’opérais ma petite révolution en attaquant la pièce par
Virginia. Changement de perspective : la fille, point de
vue pour observer le père (« Tournant autour de Galilée », en 2008, utilise les lettres de la sœur Marie-Céleste, Virginia, à son père, ndlr).
Après Virginia, particulièrement maltraitée (changée
en bigote stupide) par le père de Barbara Brecht, j’avais décidé
de m’occuper du petit moine dont on se souvient qu’il
annonce à Galilée, son maître, qu’il renonce à la science :
il ne veut pas désespérer la Campanie, nommément ses
parents, paysans pauvres ou pauvres paysans, qu’il ne
faut pas priver de croyance puisqu’ils sont privés de tout.
J’avais déjà le titre : « L’art de ne croire en rien ». Peut-on vraiment
ne croire en rien ? Brecht lui-même ne déclarait-il
pas, par Galilée interposé, qu’il croyait en la raison ?
Enfin, troisième volet de cette trilogie : écho ironique
à la fameuse scène de la vestition chez Brecht, le costard à
tailler à un pape, l’actuel, qui aura du mal à se faire à toutes
ces formes de procréation pas très naturelles que la science
nous réserve aujourd’hui, nouvelles « affaires Galilée » en
perspective ? En prime, les conséquences incalculables et
tragiques sur la filiation, sujet qui obsède le théâtre depuis
les Grecs. J’ai déjà le titre : « Naître ou ne pas naître » (spectacle que Stéphane Braunschweig présentera prochainement au Théâtre national de la Colline, si les petits cochons ne nous mangent pas d’ici-là).
L’excursion en forêt avec Thoreau n’était donc pas
au programme ; les aléas des programmations expliquent
sans doute ce détour par « Walden », et ce retour,
mais qui n’est assurément pas un recours aux forêts, la
verdure n’étant pas mon fort. C’est que le Thoreau des
années 60 n’était pas le prophète écologiste caricatural,
l’apôtre malgré lui de la décroissance qu’on a fabriqué
ces temps-ci, aïeul d’Al Gore, Yann Arthus-Bertrand et
autres Nicolas Hulot, en vacances ou en classe verte. Le
Thoreau de cette époque était plus politique ; le contestataire
par excellence, l’inventeur de la désobéissance
civile, l’abolitionniste entêté, le critique de la vie quotidienne,
de la vie mutilée, le contempteur du travail
aliénant (son précepte : gagner moins pour vivre mieux),
le zélateur d’une vie sabbatique qui, depuis sa cabane
dans les bois, vitupérait l’époque et l’esprit commercial
du libéralisme naissant (la main invisible prise dans
le sac), dénonçait l’aliénation, et prônait une vie libre,
déprise du mensonge sur soi et de la bêtise sociale. La
nature, la forêt, la cabane, on s’en moquait un peu ; en
fait, cette forêt n’était (à tort peut-être) qu’un point de
vue critique sur la société, un lieu imaginaire d’où parler,
presque une atopie.
Il était surtout un écrivain, une voix singulière, fortement
individuée, offrant une œuvre complexe, contradictoire,
irréductible à une prédication, fût-elle celle
bien commode de la décroissance au service de la bonne
pensée de la sauvegarde de la nature. Ceci ne veut pas dire
qu’il n’y a pas chez Thoreau un incurable curé toujours
prêt à faire la leçon.
Mais revenons à nos cigognes. C’étaient plutôt des
oies sauvages, comme celles qui cacardaient au-dessus de
l’étang de Walden, « l’esprit du brouillard » selon Thoreau,
des animaux qui n’aiment pas les machines : ce jour-là de
janvier 2009, elles s’étaient jetées dans les réacteurs d’un
Airbus qui réussit pourtant à se poser sur l’Hudson, on
s’en souvient. Et dans une autre machine, un chemin de
fer, je me rendais à Troy sur l’invitation de l’Empac (Experimental Media and Performing Arts Center à New York), que l’intérêt de notre théâtre pour la science et la technologie
avait incité à proposer une collaboration. J’hésitais
encore sur ce que je voulais faire (je lisais un journal qui
traitait des dossiers scientifiques qui attendaient Obama
– c’était le temps de son « inauguration » – ; j’allais bien
trouver là-dedans un beau sujet…). Pourtant face à mes
interlocuteurs, je m’entendis prononcer, comme ventriloqué,
le nom de Thoreau. Je m’entendais dire que je
voulais travailler sur Thoreau et sa cabane. Impossible de
se démentir, ce qui ne m’empêchait pas de me demander
in petto de quoi Thoreau était le nom, pour reprendre
une formulation en vogue, ni d’argumenter : moi, qui
m’intéresse à toutes les formes de réalité augmentée, qui
me suis fait une spécialité d’augmenter mes comédiens,
Thoreau, qui s’est délibérément « diminué » doit être un
bon observatoire, etc.
Je me dis alors qu’on peut l’évoquer comme un spectre
qui hanterait notre monde technologique. Un spectre
plutôt qu’un maître. Trouver la bonne distance pour lui
conserver son originalité, c’est-à-dire son étrangeté. Il faut
faire en sorte qu’il nous regarde (Thoreau nous regarde
encore) mais à la bonne distance, j’allais dire : sans familiarité.
Brecht expliquait à peu près que la distanciation,
c’était de voir le spectre (ce n’est pas le mot qu’il emploie)
de la Ford T dans toute voiture moderne. Tentons un exercice
de distanciation, d’« étrangement » donc, et voyons
dans les tours de nos cités modernes le fantôme de la
cabane de Thoreau, n’est-ce pas Jean (Nouvel) ?
2. Notes pour une nouvelle technique dramatique (rires)
A l’attention des comédiens
1 — D’une cabane l’autre. Une question qui revient sans
cesse : quelle taille elle aura votre cabane (n’est-ce pas,
Jean (Nouvel) ? Je réponds que je n’en sais encore rien, que cette
cabane n’est pas une cabane (« ceci n’est pas une cabane »).
Bien sûr, elle aura une existence matérielle, mais je ne la
vois pas comme une chose posée au milieu du plateau,
dans laquelle les comédiens pourraient entrer, d’où ils
pourraient sortir, une espèce de coulisse à vue… C’est surtout
une idée, cosa mentale. Ou plutôt une machine. La cabane,
la vraie, celle de Thoreau, n’était-ce pas d’abord une
machine et une machine à écrire (une métaphore, je l’accorde) ? Thoreau s’y retire autant pour écrire (son « Journal »
et il commence « Walden ») que pour faire l’expérience de
la vie « diminuée » dans les bois. Autant ? La vie dans les
bois est prétexte à littérature ; le livre n’est pas un simple
compte rendu d’expérience, c’est une dévoration. On sent
chez Thoreau écrivain ce désir, cette faim de tout dire ; car
pour cet homme qui salue le soleil levant, qui s’identifie
volontiers à Chantecler, tout n’a pas encore été dit et l’on
ne vient pas trop tard. Il faut se lever tôt car tout est à dire.
Dévoration ou input/output. L’expérience « existentielle »
que fait Thoreau dans sa cabane, la nature à laquelle il
s’offre et qui s’offre à lui pour être exaltée et pour être
connue (Thoreau darwinien), tout cela doit entrer dans
la machine et ressortir en phrases. Cette expérience, une
belle manip littéraire. Un beau coup au demeurant. À
nous de jouer : à manip, manip et demie ?
2 — D’une expérience l’autre. Thoreau experimentalist. Car
l’expérience, il la fait bel et bien, et à une expérience, il
faut répondre par une expérience. La cabane est un livre ;
elle est expérience de littérature. Écriture concentrée,
lecture profonde. Imaginons que notre cabane-machine
interroge l’expérience littéraire du XIXe siècle à partir de
l’expérience que font nos cerveaux d’aujourd’hui, ce qui
se formulerait, dans les termes de Nicholas G. Carr et de
son fameux article, par la révolution numérique et les mutations qu’elle impose à nos cerveaux. Soit : Thoreau
fait une expérience de vie (expérience de vie comme on
parle d’expérience de pensée), aller vivre seul dans les
bois autour d’un étang, et change cette expérience en
mots. Si notre théâtre va vivre « dans » Thoreau (comme
on dit vivre « dans » les bois) quelle expérience pouvons-nous
inventer ? À la machine livre, on peut imaginer de
répondre par une machine numérique. Input/output : on y
entre « du » Thoreau, du matériau Thoreau qui augmentera
notre machine ; il en ressort… quoi au juste ? Difficile à
dire avant que l’expérience ne soit faite. La cabane comme
moulin à paroles, boîte à images, boîte à musique… Quelle
expérience pour les cerveaux des spectateurs ? Il faudra
inviter Nicholas Carr.
3 — Thoreau/Turing. Depuis que Turing (Alan) a fait son
entrée dans notre théâtre, deux sujets nous occupent : le
rapport du vivant et de l’artificiel et le dialogue homme/
machine, qui en est l’un des aspects. Par exemple, augmenter
le comédien, l’équiper d’appareils, c’est, en l’artificialisant,
aller, à la suite de Beckett, au bout de la
dissociation du corps et de la voix, au bout de ce processus
de désincarnation de la parole. Cela mériterait une longue
réflexion qui sera pour un autre jour. C’est aussi toucher
à ce qui fait le fonds de commerce du théâtre, le dialogue,
le dialogue interhumain, entre deux ou plusieurs
sujets parlants, avec le moindre « bruit » possible entre
eux, dans la transparence la plus grande. Il faut reconnaître
que les conditions de ce dialogue ont fortement
évolué sous la pression des innovations techniques. La
machine s’interpose entre les interlocuteurs, peut les
séparer physiquement (crise exquise et fondamentale de
la présence réelle) ou les réunir par machine interposée
et à distance, etc.. Le phénomène existe depuis l’invention
de l’écriture, première mécanisation de la parole,
première dissociation de la voix et du corps – n’est-ce pas
Socrate ? – mais avouons que les choses se sont pas mal
gâtées ces derniers temps. Même l’expression oxymorique
de dialogue homme/machine ne nous étonne plus ; on
ne voit même plus combien elle est attentatoire à l’idée
de dialogue, par essence le propre ou l’un des propres de
l’homme. Que s’est-il passé ?
4 — Les machines pensent-elles (comme des humains) ? On
pourrait se faire à l’idée du dialogue homme/machine,
à la condition – les concessions commencent – que les
machines se comportent, c’est-à-dire pensent comme
des humains. « Les machines pensent-elles ? » Turing,
on s’en souvient, a feint (mais le leurre était son fort) de
vouloir répondre à la question dans son fameux article de
1950. On a cru comprendre l’astuce de la réponse, qui, au
passage, donna lieu à l’invention du « Test de Turing » ; si,
dans un jeu de question/réponse, on imagine qu’un joueur
interroge un homme et une machine et qu’il ne peut pas
faire la différence entre l’homme et la machine, alors on
peut dire que la machine pense. On a cru comprendre que
dans ce jeu de l’imitation, c’était la machine qui imitait
l’homme (elle réussissait cette imitation puisqu’il était
devenu difficile de les distinguer) ; mais c’est l’inverse
qui se passe : l’homme ayant le droit de mentir ou de
tâcher de tromper le joueur, c’est lui qui doit apporter
la preuve qu’il pense comme une machine ou du moins
qu’il a compris comment pensent (ou plutôt ne pensent
pas) les machines.
5 — Les hommes sont-ils capables de penser (comme des machines) ? « Je veux être une machine », dit l’Hamlet de Heiner
Müller. Pour ma part, je voudrais que le comédien dise
qu’il veut penser comme une machine. Par là, il nous
aiderait à comprendre comment pensent les machines
(comment on les fait penser, si ça vous rassure). Je le disais :
le comédien est bien placé pour le faire : étant lui-même
une sorte de machine, une machine à mémoire – le doute
pèse de savoir si l’on peut penser qu’il pense ce qu’il dit
(vaste programme) – et étant un imitateur professionnel,
il doit pouvoir se mettre dans la peau de la machine, non ?
Pourquoi est-il urgent de comprendre la pensée des machines
? Parce que nous vivons dans un nouveau monde
(O brave new world !). Parce que les machines d’aujourd’hui
ne sont plus de simples instruments (machines à laver, à
écrire) qui font un certain nombre de tâches à notre place.
Les machines sont désormais un milieu dans lequel nous
avons à évoluer, auquel nous avons à nous adapter, et
qu’elles font des opérations non à la place de nos jambes,
nos bras, nos mains, mais à la place de notre cerveau.
Thoreau avait déjà remarqué que ce n’était pas nous qui
nous servions des machines, mais les machines qui se
servaient de nous. Et si elles se servaient de nous pour
penser ? En tout cas, elles nous imposent leur programme,
dessinent la plupart de nos opérations cognitives. Donc,
penser avec des machines implique de penser comme des
machines. Question de survie ?
6 — Une nouvelle technique dramaturgique ? Il nous plairait
(style soutenu) que le théâtre permette de mieux pénétrer
l’intimité des machines, et que notre dramaturgie invente
une manière d’explorer cette nouvelle forme de dialogue,
de l’analyser. Que le comédien se mette dans la machine
(ça ne le changera pas tant que ça) et tâche de dialoguer
comme fait la machine. Comment ? Les machines « parlent » bizarrement : la machine ne répond pas au sens de
la proposition énoncée par son interlocuteur, le dialogue
ne progresse pas linéairement et logiquement, n’échange
pas d’arguments. Non, vous lui dites quelque chose, et
elle est un peu indifférente à vos attentes des sens ; elle
rêvasse, la machine, elle va chercher dans ses réserves,
dans ses données un mot-clé à quoi ce que vous lui avez dit
la fait penser, et elle « produit » un énoncé qui a du sens,
certes, mais qui ne « répond » pas, qui n’est pas « ajusté »
à l’énoncé de son interlocuteur. Cela ne tombe pas juste,
mais cela ne tombe pas si loin, et c’est cela qui a des effets
« poétiques ». Le dialogue au théâtre n’ayant pas besoin
d’être mimétique du dialogue réel, nous faisons un pari :
indépendamment des possibles retombées poétiques que
je viens d’évoquer ou sur lesquelles je spécule, ce dialogue
artificiel doit ouvrir de nouvelles façons de penser (terra
incognita, carrément), être porteur de transformations,
mutations cérébrales à ce jour incalculables. Une petite
révolution technique s’impose donc à l’acteur : s’il veut
parler avec la cabane augmentée (car cette cabane, un
spectateur peut, de sa place, écouter, voir ce qu’elle a à lui
dire, montrer, faire entendre, mais les comédiens peuvent
aussi interagir, dialoguer avec elle, on l’a compris), il faut
qu’il invente un nouvel usage de sa mémoire : il faudra
qu’il imite la machine, considère sa mémoire comme une
base de données, dans laquelle il ira piocher, s’il a un peu
le génie de l’association d’idées ou de mots, la réponse à
apporter. Il n’y a plus qu’à le faire.
(janvier 2010)