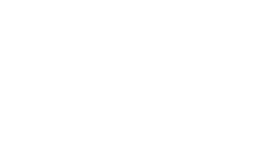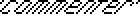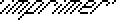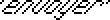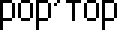
Magnetix et Yussuf Jerusalem en concert à 20h au Point Ephémère (12 euros).

Blousons noirs. Soixante ans après, l’expression a gardé toute sa force évocatrice, porteuse d’une mythologie cuir mêlant violence et rock’n’roll naissant sur fond de désœuvrement et de misère sociale (ça ne vous rappelle rien ?). Le festival Filmer la musique, que Poptronics suit quotidiennement, y consacre une journée entière avec deux films, une séance de documents d’actualité d’époque et un concert de Magnetix en clôture au Point Ephémère.
1955, « Graine de violence » (« Blackboard Jungle ») sort au cinéma. C’est l’émeute : la jeunesse française découvre en même temps les déhanchements de Presley et le « Rock Around The Clock » de Bill Haley. Les choses ne seront plus tout à fait pareilles : le rock’n’roll vient d’entrer dans la culture populaire hexagonale. Et avec lui, ceux qu’on appelle encore les « tricheurs », d’après le titre du film de Marcel Carné qui sort en 1958, ces jeunes banlieusards des cités qui sortent de terre. Il y a déjà eu quelques gros incidents : à l’été 1955, un concert de Louis Armstrong déclenche une bataille de trois jours dans les rues de Paris, en octobre 1958, le concert de Bill Haley à l’Olympia donne lieu à des débordements : des fauteuils sont détruits par centaines.
Mais c’est à l’été 1959 que la France découvre, tétanisée, les blousons noirs. Le 24 juillet, vingt-cinq jeunes de la Porte de Vanves déboulent dans le XVe arrondissement pour affronter la bande du square Saint-Lambert, vêtus de blousons de cuirs, de jeans, et armés de chaînes de vélo. Le lendemain, on se bagarre à Bandol pour une histoire de filles. Quelques jours plus tard, un policier est blessé à Cannes lors d’affrontements avec une bande de Courbevoie. L’affaire fait la Une (« Un agent de police a été sauvagement poignardé par une horde de tricheurs, de blousons noirs »). Les incidents se multiplient tellement (à la sortie de « Jailhouse Rock » en 1960, le cinéma Le Mac Mahon est littéralement pris d’assaut) que le sinistre Maurice Papon, préfet de police de Paris depuis 1958, songe très sérieusement à interdire le rock’n’roll pour préserver la « tranquillité publique ». Cette peur diffuse de la jeunesse, on la retrouve dans les reportages de l’ORTF, diffusés cet après-midi dans le cadre d’une séance INA, qui, bien qu’au ton paternaliste, stigmatisent violemment ces bandes… et font étonnamment écho à ce qu’on a pu voir récemment sur toutes les chaînes de télé au sujet des black blocks lors du sommet de l’Otan.
Bande-annonce de « Blackboard Jungle » (1955) :
Cette belle programmation du jour à Filmer la musique, on la doit à
JB Wizz, boss du label-disquaire Born Bad, tout entier dévolu au rock’n’roll. A 33 ans, il se « revendique fondamentalement de cet héritage rock soixante, le sujet me tient beaucoup à cœur, il me fascine », et revient pour Poptronics sur l’apparition des blousons noirs et leur postérité.
Dans quel contexte apparaissent les blousons noirs ?
C’est de la délinquance sur fond de rock’n’roll, de guerre d’Algérie et surtout de naissance des cités. A l’époque, face aux barres de Nanterre, La Défense est un immense terrain vague sur lequel seul le Cnit est construit. A peine sortie de terre, cette urbanisation est déjà porteuse de problèmes et provoque désœuvrement, ennui, marginalisation. Il ne fallait pas être visionnaire pour voir que ça allait être le bordel : l’environnement, c’est déjà celui de « Ma 6-t va crack-er ». Cette jeunesse ouvrière qui traîne en bas de ces grandes barres HLM nickel s’emmerde et se radicalise. Les blousons noirs terrorisent les gens, ils niquent toutes les nanas, qui toutes veulent être niquées par eux ! Ils n’ont pas de conscience politique, pas vraiment de conscience sociale non plus, ils sont dans l’énergie brute : ils foutent le bordel et c’est tout.
Quand le mouvement devient-il massif ?
Quand Hallyday débarque, en 1961. C’est un choc. Jusqu’alors, le business de la musique est aux mains de vieux qui se projettent sur les envies des jeunes et suivent les modes. On a affaire à des orchestres de bal qui jouent du twist, quelques mois plus tard ils font du cha-cha ou du calypso. Hallyday, lui, fait de la musique pour les jeunes sans une once de cynisme. Et ça, les kids, ça leur fait péter les plombs. Quand Johnny ou Vince Taylor jouent à l’Olympia au début des années 60, ils cassent tout, ça fait la Une des journaux, avec des slogans choc, ça fait flipper tout le monde car cette expression de la violence des jeunes en groupe est assez nouvelle. Les blousons noirs succèdent en quelque sorte aux apaches du début du siècle, qui eux étaient vraiment dans le banditisme. Là, ce sont des branleurs. C’est assez inédit.
C’est une esthétique aussi...
Oui, les blousons en cuir, les jeans, on est complètement dans le fantasme du motard, de « L’Equipée sauvage ». Brando, avant James Dean, devient une véritable icône de cette jeunesse. Il y a un côté désuet à les revoir aujourd’hui, un mélange de pathétique et de sublime. Le phénomène est assez européen, très présent en Suisse, en Allemagne, mais en France, c’est quelque chose de dur, le cuir, les chaînes, il y a une volonté d’effrayer le bourgeois, de faire peur, un vrai désir de choquer et de provoquer. Aux Etats-Unis, on ne trouve pas tous ces atours, tout cet apparat.
Tu présentes deux films qui rendent compte de cette réalité banlieusarde : le documentaire de Jean Vautrin « Le Chemin de la mauvaise graine » (1962) et le très rare « Les Cœurs verts » (1966) d’Edouard Luntz. Qu’est-ce qui les rend plus emblématiques que d’autres ?
Les témoignages sont rares ; il existe peu de photos, peu de films et les études faites à l’époque par des chercheurs n’ont plus aucun sens. C’est ce qui rend ces deux films très intéressants, car on n’y juge pas les blousons noirs. « Le Chemin de la mauvaise graine », c’est un document-vérité avec un montage aventureux façon « La Jetée » et une liberté de ton assez moderne pour l’époque. Les jeunes parlent longuement, très libres dans leurs propos, c’est une véritable tribune d’expression. Quant aux « Cœurs verts », c’est un film magnifique et méconnu, très avant-gardiste dans son esthétique épurée, avec les mecs qui jouent leur propre rôle. C’est un film très important sur la jeunesse de l’époque, je rêve de l’éditer en DVD ! Ce sont deux témoignages qui échappent aux clichés sur la violence, assez bruts de décoffrage.
Les blousons noirs disparaissent peu à peu au cours des années 60. C’est la fin du rock’n’roll dans les cités ?
Difficile de dater la fin du mouvement, beaucoup rentrent dans le rang assez vite (selon quelques rares études, plus de la moitié des blousons noirs ont entre 14 et 17 ans, huit sur dix ont moins de vingt ans, ndlr), une petite frange tombe dans la vraie marginalité. Mais le rock ne disparaît pas pour autant du paysage banlieusard. Le rock’n’roll n’a quitté les cités qu’avec l’arrivée du rap. Jusqu’au début des année 80, tout le monde y écoute du rockabilly et du rock’n’roll, qu’on soit blanc, black ou arabe. Gene Vincent est une star des cités. D’ailleurs, ceux qui ont fondé les premiers labels de rap étaient tous d’anciens fans de rockabilly.
| matthieu recarte |
 |

Ah ça IA, ça IA, ça IA
L’icône Susan Kare
« Ultima », l’expo plein jeux à Nantes
F.A.M.E, la musique en plan large

Art Orienté Objet : « J’ai ressenti dans mon corps la nature très vive du cheval »
Métavers, tout doit disparaître (et Hubs aussi)
Papillote infuse un brin de permaculture dans le jeu, l’art et les réseaux
L’IA n’a pas halluciné cette Papillote