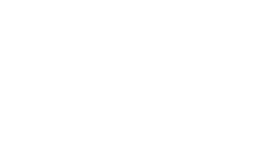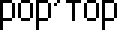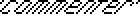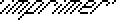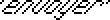En guise de métaphore de la réduction du monde et de l’art, Walid Raad présente au CentQuatre la maquette d’une exposition que sa galerie avait organisée à Beyrouth, en 2005, où ses photos, vidéos, et archives avaient été réduites au 1/100e. © Galerie Sfeir-Semler
< 04'12'10 >
Walid Raad : et si l’art (d’aujourd’hui) m’était conté (demain)… (1/2)
L’événement se produit dans les années futures, à Aman. Entre 2014 et 2024, un homme quelconque, un visiteur en somme, s’avance pour assister à l’inauguration du premier musée d’art moderne (et contemporain) de l’histoire culturelle du monde arabe. L’homme, refoulé, se retourne vers la foule qui attend. Il crie, il alerte : « Ne rentrez pas ! Il n’y a qu’un mur ! » Et le narrateur de l’audioguide, qui accompagne le visiteur à l’exposition-performance de Walid Raad, « Scratching On Things I could Disavow : A History of Art In The Arab World », au CentQuatre, achève son récit, là. L’homme, arrêté pour démence, s’est confronté à la réalité contemporaine de « l’aplatissement du monde ».
Nous, visiteurs, en conclusion, nous trouvons devant des murs projetés en 3D sur un écran placé en hauteur. Murs écrasants, murs à la fois familiers et inidentifiables, murs vides aux couleurs plates, murs disproportionnés, monumentaux, n’existant que pour eux-mêmes, qui attirent et figent notre vision dans le rien. Murs mêlés, enchaînés, superposés des grands musées occidentaux modernistes – du Louvre au Guggenheim. Et les effets optiques de la projection holographique, aussi séduisants qu’inquiétants, ne changent rien à ce rien. Pire, ils le démultiplient, démultipliant ce phénomène de l’« aplatissement » du réel et du regard, dans un monde où l’art s’est étréci, réduit, mis au format des institutions muséales, des galeries, des expositions « white cube », des collectionneurs et du marché. Il n’y a rien à voir, parce que l’art n’est plus là. Ne restent que les conséquences d’un état des choses. Il ne fallait pas entrer, le visiteur du futur proche nous avait prévenus !
Dans le présent de l’exposition-performance-lecture du fondateur de l’Atlas Group, ce collectif fictif d’archivage des mémoires des guerres civiles libanaises, le spectateur re(joue) la scène prospective qui lui a été racontée. Une fable politique et esthétique que Walid Raad a conçue pour le Festival d’automne. Nous sommes donc quand même entrés… dans un espace qui s’organise de façon minimale, bien davantage comme une scène de théâtre que comme un lieu d’exposition. Nous sommes conduits de décor en décor comme autant de chapitres passés de l’œuvre de l’artiste libanais. Chapitres ou actes. Quoi qu’il en soit, le cheminement physique ou la narration se fait en cinq moments qui entrelacent temps présent, temps rétrospectif et temps futur. C’est une histoire, c’est aussi une tentative de constituer une histoire de l’art arabe, et de l’art au XXIe siècle.
Cinq actes (cinq chapitres). Premier acte : les échanges financiers et les flux du marché de l’art moderne et contemporain, avec ses acteurs principaux : les sociétés d’agents d’art (comme APT qui gère des fonds de pension pour artistes, fixe des cotes, établit des prévisionnels sur les goûts des acheteurs d’œuvres, etc.), les maisons de ventes aux enchères, les nouveaux musées qui se construisent dans les pays du Golfe sous les marques Louvre, Guggengheim, MoMa, les transferts d’investissement de l’industrie vers le tourisme et l’art, les architectes stars de ces institutions culturelles (de Jean Nouvel à Frank Gehry, en passant par Zaha Hadid et Norman Foster)… Des noms phares, des villes marchés (Dubai, New York, Berlin, Londres, Pékin…), des noms de sites de transactions (face.com, mutualart.com) où artistes et collectionneurs peuvent s’inscrire, une cartographie plane de ce monde qui bâtit une histoire de l’art dans le présent du capitalisme financier.
Et le récit-parcours de Walid Raad se poursuit avec une maquette de l’une de ses propres expositions qui s’est tenue à Beyrouth, en 2005, et organisée par la galerie Sfeir-Semler. La chose pourrait être anecdotique ou narcissique. Mais étonnement et effarement de l’artiste de découvrir que dans l’espace du « white cube », ses photographies, ses vidéos, ses œuvres archives, ses dessins avaient été réduites au 1/100e de leur taille originelle. Énigmatique phénomène certes, métaphore de la réduction du monde et de l’art.
Puis, c’est un mur de cimaise déchiré, le temps remémoré des guerres libanaises. Il faut archiver le nom de tous les artistes de l’histoire de l’art moderne libanais, les inscrire et les écrire sur des murs, les faire réapparaître par leur nom, à défaut de leur œuvre. Il peut y avoir des erreurs, l’oubli fait commettre des erreurs. Les destructions matérielles, les destructions physiques, Walid Raad les a auscultées, les a exposées dans son projet de l’Atlas Group, où l’archive témoin des conflits, des morts et des disparitions est inventée, réinventée pour traquer le réel fuyant.
Chapitre central, magnifique, de cette fable, les destructions immatérielles, la disparition de la couleur. Ainsi, selon l’expression de l’artiste écrivain Jalal Toufic avec qui Raad travaille depuis 2007, la couleur est « affectée ». Ainsi, les couleurs ne sont plus disponibles. Non pas tant qu’elles n’existent pas, elles sont juste présentes dans leur indisponibilité, elles sont ou se sont rendues invisibles, après ce que Toufic, dans son livre « The Withdrawal of Tradition Past a Surpassing Disaster » (« le retrait de la tradition après un désastre démesuré »), définit comme « un désastre démesuré ». Certes à cause des destructions, mais aussi en raison des conditions nouvelles du monde de l’art. Les couleurs sont entrées en résistance, elles se cachent, se camouflent. Nous n’avons plus à notre disposition que des documents ou des doubles des couleurs, des lignes, des formes, jamais plus l’original. Aux artistes, aux écrivains, aux poètes, aux philosophes de les rendre de nouveau disponibles, visibles.
La force de la proposition de Walid Raad – exposition-performance-lecture : aucun terme ou catégorie de la langue exposition ne peut enfermer et contenir ce qui se produit dans l’Atelier 4 du CentQuatre ! – est que, sous cette parole contée, il rend si sensible ce qui « affecte » l’art en ces débuts du XXIe siècle. Et il ne s’agit pas tant de revenir sur les effets et les conséquences de la globalisation (plane, donc) du monde que de résister à l’arasement des mémoires, des architectures, des formes, des couleurs, des multiplicités, des libertés, des pensées, des goûts.
Walid Raad commet un manifeste de résistance. Ou bien nous raconte-t-il peut-être une version XXIe siècle de « la peau de chagrin » ? Aplatissement, réduction, arasement, l’art trouve des modes opératoires de présence : l’artiste effectue aussi un travail d’exhumation. S’il pose la question de savoir si la logique du « white cube » rendra visible l’art arabe, il en ouvre une plus vaste encore, sur l’art en production aujourd’hui… C’est à la Whitechapel Gallery, à Londres, que Walid Raad, avec « Miraculous Beginnings », réinterroge dans le « white cube » la proposition narrative. A suivre…
|
marjorie micucci-zaguedoun
|
|
 |