
|
Interview fleuve d’Elisabeth Lebovici et de Catherine Gonnard à l’occasion de la parution de leur livre-somme « Femmes artistes, artistes femmes. Paris de 1880 à nos jours », aux éditions Hazan.
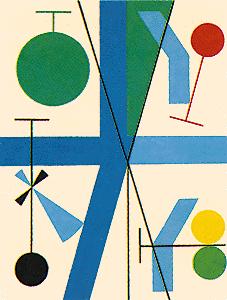
« Quatre espaces à croix brisée », Sophie Taeuber (1932). © DR
< 07'12'07 >
interview « L’histoire de l’art, c’était l’histoire des hommes artistes »
Elisabeth Lebovici (rédactrice en chef du pop’lab de poptronics) vient de publier avec Catherine Gonnard un ouvrage plutôt définitif (deux kilos !) aux éditions Hazan, « Femmes artistes, artistes femmes. Paris de 1880 à nos jours », un sujet absolument inédit en France. Sans verser dans l’auto-promo (quoique...), poptronics ne souhaite pas priver ses lecteurs d’éléments de réflexion pour éventuellement se précipiter en librairie acheter le bouquin.
Nous publions ci-dessous une longue interview de Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici, réalisée par Marjorie Micucci-Zaguedoun en juillet dernier. L’interview en PDF (cliquez sur l’icone pour la télécharger pour un meilleur confort de lecture) : Comment est née l’idée du livre ? Elisabeth Lebovici : Le livre est né d’une obsession, celle de Catherine. Depuis des années, elle cherchait, recueillait, rassemblait une documentation sur tout ce qui concernait les artistes femmes du XXe siècle, plus précisément de la première partie du XXe siècle, alors que rien n’existait, absolument rien. Il fallait en faire un bouquin… Catherine Gonnard : Le livre part d’un constat. Assez communément, tout le monde dit ne pas connaître, ou quasiment pas, de noms de femmes artistes, de femmes peintres, à part un ou deux noms comme Marie Laurencin. Et pourtant, si on cherche un peu, on trouve, finalement, pas mal de noms de femmes artistes et des œuvres visibles dans les musées. Alors, à partir de là, on se demande : « Mais que s’est-il passé ? » Une expérience très facile à faire : vous entrez dans un musée et vous demandez où sont les œuvres de femmes. C’est une question qui laisse perplexes, par exemple, les personnes de l’accueil, parce qu’elles ne savent pas toujours où elles sont. Et si vous regardez attentivement dans les salles, vous en découvrez beaucoup plus que vous ne pouviez l’imaginer. Simplement lorsque l’on va dans un musée, on cherche, a priori, les noms connus, les noms légitimés par l’histoire de l’art. Et les noms des femmes artistes sont moins connus, et donc, on ne regarde pas les tableaux. Une œuvre n’est pas en soi féminine ou masculine, mais, a priori, ce ne sont que les œuvres d’hommes que l’on regarde, que l’on voit… L’Etat, les musées acquièrent assez tôt des œuvres réalisées par des femmes… C.G. : Tout au long du XIXe siècle, l’Etat, dans sa politique d’acquisition, achète des œuvres de femmes, moins que des œuvres d’homme, mais simplement parce que leur nombre n’est pas le même. Il n’y a aucun refus de l’Etat, des institutions, d’acheter des œuvres faites par des femmes. Autre phénomène intéressant et complexe, les commandes officielles. Beaucoup de femmes, dans cette période, travaillent pour des mairies, des églises. Elles reçoivent des commandes de fresques peintes, de sculptures. Louise Abbéma par exemple, réalise les décors des mairies de Paris. Hélène Bertaux, sculptrice dans les années 1870-1880, conçoit une série de sculptures pour le jardin des Tuileries ; à Amiens, également, où elle fait pour la municipalité une énorme fontaine. Même Camille Claudel a eu des commandes de l’État. Donc, les femmes sont présentes, mais avec cette notion qu’elles sont plutôt de bonnes praticiennes, plutôt de bonnes « copieuses » que des créatrices. Où ces femmes pouvaient-elles se former ? E.L. : Ça, c’est le grand problème, et c’est là que commence notre livre, par cette question de la formation. Jusqu’à l’ouverture d’un atelier spécifique à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris au début du XXe siècle, grâce aux luttes importantes menées par une association d’artistes femmes, celles-ci se forment dans les académies privées, comme l’académie Julian. Il faut rappeler qu’à l’époque les femmes n’ont pas le droit de travailler avec des modèles vivants nus, qu’ils soient hommes ou femmes. Pour devenir des artistes professionnelles, les femmes doivent payer. C’est comme cela que tout commence ! C.G. : A partir des années 1880-1890, les femmes commencent à arriver en nombre en France, à Paris, pour apprendre, se former. Elles viennent de partout. Il y a des Australiennes, des Finlandaises… Il suffit de feuilleter les dictionnaires, les ouvrages publiés dans de nombreux pays sur les artistes femmes dans les années 1870 – pas tellement en France –, et l’on trouve presque toujours un chapitre consacré à celles venues travailler à Paris. E.L. : Comme les hommes d’ailleurs ! Paris est la capitale du XIXe siècle. Dans notre livre, nous essayons aussi de comprendre ce que signifiait venir à Paris pour une femme. On voit toujours l’histoire du point de vue universel, c’est-à-dire du point de vue masculin. Par exemple, l’histoire de l’art la plus anecdotique nous raconte la vie des cafés. Oui, effectivement, l’art se fait alors dans les cafés, il se fait la nuit. Pour une jeune femme qui arrive à Paris pour se former, pour devenir artiste, il se pose un certain nombre de problèmes que les hommes ne connaissent pas. Et, voilà, c’est fascinant, passionnant, de poser la question de ce qu’implique pour une femme d’être dans une ville sans avoir les mêmes droits et les mêmes possibilités que les hommes. Et, là, on s’aperçoit que l’histoire est faite toujours du point de vue masculin. La vie la nuit, la vie des cafés, les types de conversations, les discussions conceptuelles que les hommes ont pu avoir entre eux, et dont ils ont exclu les femmes comme ils les ont exclues de la pratique de l’art. Nous avons essayé aussi de transcrire cela : le rapport des femmes avec le dehors, avec la rue, avec les magasins, avec le café, etc. C’est pour cela que notre histoire des femmes artistes est indissociable de l’histoire des femmes en général, de l’histoire du genre et de l’histoire sociale et politique de la France. Toutes ces histoires sociales et culturelles se glissent dans l’histoire des formes et de l’esthétique, ce que l’on ne prend pas toujours en compte lorsque l’on fait de l’histoire de l’art en général, c’est-à-dire l’histoire des hommes artistes. Quel est le parcours de ces femmes qui font le choix d’être artiste ? Vous parlez de « stratégies » pour se faire accepter. C.G. : Pour la fin du XIXe siècle, nous avons choisi quelques parcours de femmes artistes, qui vont être ou pas revendiquées par un courant artistique, un groupe d’artistes. L’exemple de Rosa Bonheur est un cas passionnant. Issue d’une famille de peintres, elle va mettre en place effectivement un ensemble de « stratégies » pour pouvoir réellement exister. Ainsi, quand elle expose au Salon, elle peint des animaux qui ne sont pas ceux peints par les hommes. Elle fait de vrais choix pour être la seule dans ce qu’elle fait. Et sa thématique animalière la soustrait à un ensemble de problèmes que les femmes ont à l’époque lorsqu’elles commencent à peindre. En premier lieu, celui de l’anatomie et du modèle vivant. Elle écarte ce problème qu’a eu, par exemple, Camille Claudel, de devoir se faire respecter du modèle. Et, d’ailleurs, les hommes disparaissent quasiment de sa peinture, ou alors ils ne sont présents que dans des scènes agricoles. Le thème agricole dans un pays où l’agriculture est très prégnante dans les activités et les représentations, c’est un thème référent, populaire ; c’est là aussi une de ses « stratégies » pour s’imposer. Par ailleurs, elle comprend très vite l’importance commerciale de la peinture, l’importance de la reproduction de son travail par la gravure, notamment, l’importance que les Etats-Unis vont jouer pour la diffusion des œuvres. Enfin, elle crée autour d’elle toute une mythologie. Elle se crée un personnage qui la met à part, mais qui, en même temps, fait qu’elle est acceptée et acceptable. C’est un mélange de bonne femme de la campagne, qui adore les animaux, et qui porte des pantalons – par autorisation spéciale de l’empereur Napoléon III –, qui fume… Elle a une vraie place dans l’histoire de l’art parce qu’elle est atypique. La deuxième artiste que nous avons choisie, c’est Berthe Morisot qui est l’opposé de Rosa Bonheur. Berthe Morisot vient d’un milieu totalement différent, d’un milieu de fonctionnaires de l’État, son père est préfet. La « stratégie » de Berthe Morisot va consister à s’inscrire, s’insérer dans un mouvement moderniste, l’impressionnisme. Un mouvement qui peut accueillir une femme, parce qu’il travaille sur des formats plus petits faits pour des intérieurs bourgeois, parce qu’il travaille aussi sur l’intime. D’autres femmes vont pouvoir avoir cette même attache avec le mouvement impressionniste : Marie Cassatt, Eva Gonzalès… Le troisième exemple, c’est Louise Breslau, qui fait le choix de la peinture comme profession. Elle vient à Paris pour se former, pour apprendre, puis elle s’assume professionnellement comme artiste. Ne venant pas d’une famille aisée, elle doit vraiment peindre pour vivre. Une nouveauté que même les critiques contemporains souligneront. E.L. : Nous nous sommes également intéressées aux rapports de ces femmes avec l’avant-garde dans le Paris des années 1900-1914. Nous avons essayé de voir où s’étaient placées les femmes dans ces problématiques formelles. Mais dans le même temps, alors que s’ouvre un atelier pour les femmes à l’Ecole des Beaux-Arts, nous avons aussi voulu comprendre comment un certain nombre de femmes vont faire carrière dans ce nouveau contexte institutionnel, quelles voies officielles elles vont suivre. Il se produit un double phénomène essentiel au début du XXe siècle : l’extinction du prestige de l’Ecole des Beaux-Arts – aux yeux des hommes, celle-ci est liée à un enseignement très académique de l’art – et l’explosion des avant-gardes. Comment les femmes s’y inscrivent ? Difficilement, très difficilement. On a même l’impression que le début du siècle est un moment bien plus complexe pour les femmes. Ce qui se passe dans le champ de la sculpture est intéressant à cet égard. Beaucoup de femmes vont chez Rodin, il attire des femmes qui jouent tous les rôles : elles sont modèles, elles sont artistes, elles sont danseuses, elles sont photographiées. Il y a là toute une pratique de l’art où les femmes peuvent s’insérer. Une sorte de pratique déléguée de l’art. En revanche, dans tous les mouvements en « isme » qui apparaissent au début du siècle, il faut bien constater que la place des femmes est subsidiaire. Elles arrivent un peu plus tard. On le voit assez bien avec le cubisme. Picasso et Braque lancent le mouvement, les femmes, après, y seront nombreuses. Enfin, relativement ! Alors, nous avons essayé de repenser les choses autrement, de refaire d’autres groupes. Pourquoi se limiter aux choses en « isme » ? Pourquoi ne pas tenter de trouver d’autres stratégies, d’autres recoupements ? Par exemple, nous avons observé la présence massive des Russes qui viennent à Paris. Celles qui deviendront, de retour en Russie, le fer de lance de la Révolution, ou celles qui restent à Paris. Nous nous sommes demandé ce qu’elles avaient apporté en tant que groupe et nous sommes aperçu qu’il se passait quelque chose. Les femmes repensent les questions esthétiques, comme beaucoup d’hommes à l’époque, la question de l’art total, la question du rapport entre les arts dits nobles et les arts décoratifs. Arts décoratifs que les femmes considèrent d’emblée comme esthétiquement nouveau. Quand Sonia Delaunay tisse une couverture pour son fils, c’est en même temps que la découverte de l’abstraction, et cette couverture est une couverture abstraite. On peut dire que Sonia Delaunay est l’une des premières artistes abstraites. Sonia Delaunay est extrêmement présente dans votre livre. Elle traverse tout le XXe siècle. E.L. : Nous avons deux « chouchoutes », et elles étaient amies. Sonia Delaunay et Sophie Taeuber. Pourquoi ? Parce qu’il y a énormément de choses qui s’articulent autour de leur travail. D’une part, la question des arts décoratifs. Question qui sera reposée par les féministes… On a d’un côté, le modernisme, et de l’autre, tous ces mouvements d’avant-garde qui cherchent à faire éclater les frontières de l’œuvre. Dans ces mouvances, il y a des artistes comme Sophie Taeuber, qui pratique la danse, la performance, qui commence, elle aussi, à réaliser des œuvres abstraites, en tapisserie, en tissu, en broderie… avant de les créer sur papier. Tout comme Sonia Delaunay qui a fait des vêtements, des costumes pour le cinéma… On constate donc cette volonté d’ouvrir, qui, d’ailleurs, est liée aussi à des questions sexuelles. Pas seulement parce que l’on trouve que c’est plus féminin de faire des tissus, des vêtements que des peintures, mais aussi parce que ces deux femmes sont liées à un homme, et qu’à chaque fois leurs rapports avec cet homme sont posés. Pour Sonia Delaunay, c’est connu. Elle a mené sa carrière d’artiste de main de maître, et c’est aussi elle qui gagnait l’argent du ménage. C’est poser la question matérielle d’une vie d’artiste… E.L. : Cela se pose pour toutes les femmes. Quand on a à faire à une biographie d’artiste homme, cette question matérielle n’est pratiquement jamais abordée. La question des petits boulots… Le travail de recherche que nous avons effectué permet de lancer quelques pichenettes à des questions que l’on ne pose pas d’habitude dans la vie des artistes, et par exemple comment on vit… Sophie Taeuber, contrairement à Sonia Delaunay, elle est dans une autre relation de couple avec son mari. Ils ont envie d’effacer la différence et de produire des œuvres qui sont anonymes, où effectivement les caractéristiques sexuées ne se distinguent pas, où la prévalence du travail masculin sur un travail féminin qui serait plus décoratif et qui, en plus, servirait à « faire bouillir la marmite », ne se verrait pas. Deux stratégies complètement différentes ! C.G. : La question matérielle est très bien posée par les femmes qui vivent seules, qui ont un enfant à charge, comme Marie Vassilieff. Quand on lit le manuscrit où elle raconte sa vie, on se rend compte que le fait d’avoir la responsabilité de cet enfant l’oblige à penser les choses différemment pour vivre. Il y a la nécessité d’accepter des travaux plus alimentaires, mais il y a un autre aspect. Quand Marie Vassilieff commence ses poupées – que nous avons adorées –, l’idée lui en est venue à cause de son fils. Leur travail artistique même est donc aussi profondément lié au quotidien, à leur quotidien. E.L. : Et c’est normal ! Si on regarde dans le cubisme, les collages des hommes, nous avons les objets quotidiens de l’univers masculin de l’époque : le journal, la bouteille de vin. Quand on va du côté des femmes, ce sont d’autres objets, en rapport avec leur quotidien. Parce qu’on fait aussi de l’art avec les choses qui nous entourent. C.G. : …mais on peut s’interroger sur ce que signifie « faire des trucs de femmes », les construire et les déconstruire. C’est ce que vont faire les artistes femmes dans les années 1970. Après tout, n’est-ce pas, une cafetière est neutre, ce n’est ni masculin ni féminin. Un journal, c’est neutre. Donc pourquoi lie-t-on la cafetière à la femme et pourquoi fait-on du journal un élément masculin ? Pour arriver à déconstruire ces regards féminin et masculin dans l’art, il faut du temps, parce qu’il faut comprendre que l’on est en train de coder quelque chose, ou plus exactement que l’on a codé quelque chose et qu’il faut le décoder. E.L. : A propos de ces histoires de babioles, par exemple, dans nos recherches sur le surréalisme, nous nous sommes aperçu que l’entrée des femmes dans le mouvement surréaliste était en rapport avec ce moment où Breton célèbre l’objet. Avant, quand il célèbre la peinture, quand il s’intéresse aux peintres, il ne s’intéresse pas tellement aux femmes, c’est un homme assez sexiste. Nous avons essayé de comprendre pourquoi quand l’objet surréaliste entre sur la scène artistique, il y a tout d’un coup des femmes. Il y a Claude Cahun qui écrit : « Prenez garde aux objets domestiques. » Nous avons essayé de retracer ce phénomène à un moment des années 1920 où, justement, plusieurs femmes font ce qu’elles appellent des « babioles », et elles le font pour gagner leur vie. En particulier, Alice Halicka, la femme de Louis Marcoussis. Elle fait des espèces de constructions, des collages, etc. qu’elle vend moins cher que des œuvres. Et c’est une source dont on ne parle jamais. C’est la fabrication de quelque chose qui prend une sorte de charme au sens vraiment chimérique du terme. Et entre la « grande peinture » qui fait, après la Première Guerre mondiale, l’objet d’un grand retour à l’ordre et d’un grand retour au figuratif, et l’abstraction la plus pure, on pourrait voir dans tous ces objets fabriqués une source cachée pour l’histoire de l’art. Mais avez-vous quand même dans cette période de l’après Première Guerre mondiale, dans la période des années 20, ces « années folles », noté, repéré des changements de regards, d’attitudes ? E.L. : Oui et non. C’est la contradiction des années 20. Lorsque les hommes partent au front, les femmes s’émancipent, mais quand ils reviennent, ils votent des lois extrêmement réactionnaires. Il y a ce raidissement législatif à l’égard des femmes pendant cette période, notamment la législation sur l’avortement qui, à partir de 1920, punit de mort les avorteuses. Ce mouvement social qui voit monter en force la fin du corset, le port du pantalon, la garçonne, les cheveux coupés courts, cette idée d’une émancipation des femmes, est aussi un moment où les lois deviennent moins émancipatrices. Et, cette ambiguïté est parfaitement reflétée par ce qui se passe pour les femmes dans le champ artistique. Par exemple, c’est dans ces années que l’on voit surgir énormément de femmes photographes. C’est l’appropriation d’un médium neuf et cela correspond très bien avec cette idée d’émancipation. Parce que cela veut dire s’approprier la rue, faire des images et pouvoir les vendre, cela veut dire utiliser toutes les recettes du modernisme, se former dans les meilleures écoles, au Bauhaus, à l’Académie moderne. Mais, d’un autre côté, on se rend compte que dans les milieux de l’abstraction, les femmes n’ont pas énormément de place. Les hommes sont tout à fait d’accord pour qu’elles viennent se former dans les académies, mais elles n’occupent pas de place comme conceptuelles. Ce sont les hommes qui parlent de l’art abstrait. C.G. : La seule qui arrive à le faire, qui arrive à théoriser, c’est Sophie Taeuber. On peut penser que c’est à cause de son parcours et de sa relation avec Arp. E.L. : Par ailleurs, il y a un troisième phénomène. C’est la première fois que les femmes se réfèrent à elles-mêmes. D’un côté, tu as Romaine Brooks qui ne peint que des femmes, des lesbiennes, des femmes qui s’assument en tant que lesbiennes. Et, d’un autre côté, tu as une floraison d’artistes femmes qui s’assument professionnellement comme artistes. Elles participent aux Salons, ont des expositions, vendent, ont des critiques. Une réelle émancipation professionnelle qui est en rapport avec l’évolution de la société française. D’une part, pendant ces années 20, des lois réactionnaires sont votées, et d’autre part, un certain nombre de femmes se trouvent au cœur de la modernité sur le plan littéraire, sur le plan médical, sur le plan des inventions, etc. Et il y a ce grand mouvement de professionnalisation des femmes qui accèdent à des métiers. Qu’apportent de particulier les artistes qui viennent des Etats-Unis ou d’Union soviétique ? E.L. : C’est intéressant pour les Américaines. Elles recréent des communautés d’expatriées. Et l’on s’aperçoit qu’il y a peu d’interaction entre ces femmes qui viennent en France pour y vivre et les artistes françaises. Les Russes, elles, se francisent ; les Américaines, elles, restent américaines. Elles ne s’intègrent pas. Et même avec des artistes, peintres ou sculpteurs, aucun lien ne se noue ? C.G. : La seule qui passe un peu tout ce réseau d’Américaines, c’est Marie Laurencin. E.L. : Qui, elle aussi, est une artiste complètement stratégique dans ses choix. C.G. : Elle est passionnante. Elle a compris où elle pouvait avoir une place et comment elle pouvait travailler dans cet espace. Elle est d’abord rejetée par son pays : en 1914 elle se marie avec un Allemand, trois semaines avant la déclaration de guerre, elle perd sa nationalité française et doit quitter la France. Avant, elle est encore dans des tentatives modernistes, dans la recherche, elle essaye de faire un peu de cubisme. Quand elle revient, elle fait du Laurencin, ça plaît, ça marche, et elle devient complètement indépendante. Cette femme a compris que, bien sûr, il y avait son art, sa recherche, mais que si elle voulait vivre, il fallait qu’elle accepte d’être ce que l’on demandait alors à une femme artiste. A partir de ce moment, elle a une vraie place, elle a de l’argent. Elle fait du Laurencin pour continuer. E.L. : Et c’est assez amusant à noter aujourd’hui où il y a bien des historiens d’art contemporain qui parlent plus de stratégies que de formes. De stratégies d’artistes. Et avec Marie Laurencin, on voit très bien que c’est une stratégie d’artiste, c’est-à-dire faire exactement ce qu’on lui demande d’être. Dans les années 30, un certain nombre de femmes artistes font le choix de partir travailler dans les colonies. Est-ce là aussi une question de stratégie ? E.L. : Les colonies sont des débouchés. C’est aussi un rapport au corps des autres qui diffère. Le rapport avec le colonisé pour une femme est double. Il est, d’une part, la possibilité de se retrouver pas dans la minorité, mais plutôt du côté du colonisateur. Mais, d’un autre côté, il peut y avoir un rapport entre colonisés et femmes. Et c’est vraiment intéressant, parce que l’on verra dans les années 60 que l’essor du féminisme est lié aux guerres de décolonisation. Les femmes allaient dans les colonies pour pouvoir voyager, pour être libres. Elles quittaient leur famille, leur milieu, elles ont des bourses d’Etat. Elles ouvrent des écoles d’art, notamment en Indochine. Malheureusement, on a peu de sources sur l’Afrique et sur l’Indochine. Il n’y a pas beaucoup de choses non plus sur les Antilles. Les femmes ont des commandes pour les hôtels de ville, les églises. Et puis, il y a le retour à Paris, avec les commandes qu’elles peuvent honorer pour les Expositions universelles, pour la fameuse exposition coloniale de 1937, et pour cet intérêt très fort, à l’époque, pour l’« autre », pour les « indigènes », pour ce que l’on a appelé la « négrophilie ». C. G. : Il y a une femme qui est assez étonnante de ce point de vue, c’est Lucie Cousturier. Elle va découvrir, peu à peu, ce qu’est le racisme et la colonisation, et elle va réfléchir, travailler là-dessus. Elle est la seule qui travaillant en Afrique ne va pas choisir l’exotisme comme représentation. Lucie Cousturier était une néo-pointilliste qui avait écrit sur Seurat et Signac. Elle se retrouve dans le Sud de la France pendant la guerre de 1914, habitant près des camps où sont mis les soldats sénégalais pour qu’ils s’acclimatent, avant de les envoyer au front. Et Lucie découvre donc ces hommes. Elle a toutes ces idées préconçues, ces stéréotypes qu’ont les Blancs et les femmes blanches de l’époque. Elle rencontre ces hommes, elle se rend compte de la bêtise de ses préjugés, et décide de leur apprendre à écrire. Elle déconstruit alors ce que l’on appelait le « petit nègre » qu’elle trouve aberrant. Elle comprend comment le Blanc a enfermé le colonisé dans un langage particulier. Elle part en Afrique, vit avec des Africains. Elle écrira dans « Le Paria », l’un des premiers journaux à défendre les Noirs. Et après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50… E.L. : Après la guerre… ce sont des années complexes. Les années 50 sont des années de renouvellement de générations. Ce sont aussi des années d’oubli, des années où l’on refoule tout ce qui s’est passé sur le plan collectif avant-guerre. Il y a juste dans l’immédiat après-guerre une courte période où tout est possible, et puis les choses se referment très vite. En parallèle avec « Le Deuxième Sexe », de Simone de Beauvoir, nous avions intitulé un chapitre « Le deuxième sexe de l’abstraction ». Pour souligner le fait que, effectivement, après la guerre, les femmes sont toujours dans une position de secondarité, jusqu’aux années du féminisme. Bien sûr, il y a de grandes individualités comme Vieira Da Silva, comme Germaine Richier, comme Joan Mitchell qui arrive en France. Le début des années 50 est marqué par un développement de l’individualisme artistique. Il n’y a plus de conscience politique, il n’y a pas de conscience historique. Il n’y a plus cette idée que l’art est une pratique sociale. Sauf pour certains groupes proches du Parti communiste. On a vraiment l’impression que ce sont des individualités qui se développent à l’intérieur de petites cellules comme Arpad Szenes/Vieira Da Silva, Hans Hartung/Anna Eva Bergman… Et l’on n’a pas non plus vraiment la sensation que cet état produit une structuration sociale des artistes. Et cela continue dans les années 60. C’est effrayant de constater comment tous les nouveaux mouvements qui apparaissent, comme le Nouveau Réalisme, prennent peu en compte les femmes. Dans le Nouveau Roman, il y en eut deux, Duras et Sarraute, dans la Nouvelle Vague, Agnès Varda était un peu écartée. Niki de Saint-Phalle était la seule femme du Nouveau Réalisme. Il faut attendre cette conscience de la décolonisation, Mai 68 et le féminisme pour voir ressurgir une sorte de conscience sociale des femmes artistes/des artistes femmes. Là, ça peut constituer une entité intellectuelle. C. G. : À partir des années 50-60, il y a un éloignement de la notion d’art féminin, de l’idée d’être une femme artiste. Les femmes veulent être des artistes, elles veulent être comprises comme des individualités artistiques. Et il va falloir un certain temps après la parution du Deuxième Sexe pour que sa lecture fasse apparaître une nouvelle conscience, une nouvelle génération. E.L. : Nous avons intitulé un chapitre « Solitude et liberté » où nous montrons que des individualités artistiques s’affirment, comme Aurélie Nemours. Aurélie Nemours a un très long apprentissage, puis elle trace un chemin toute seule. Elle a une première exposition en 1953 chez Colette Allendy. Mais elle est reconnue très tard, dans les années 80. Il y a donc une longue traversée du désert sur le plan de la reconnaissance sociale pour ces femmes mais, en même temps, elles ne perdent jamais l’idée qu’elles sont artistes. Elles n’abandonnent jamais. Ou peu. Ce sont des femmes qui sont tenues par l’idée qu’elles sont dans la recherche. C’est le cas d’Aurélie Nemours, c’est le cas de Geneviève Asse, c’est le cas de ces femmes qui sont des consciences pures d’artistes. Il n’est plus question d’aller faire des petites babioles pour gagner sa vie. C’est vraiment la recherche artistique comme sorte de but ultime à atteindre. On revisite là les années 50-60, qui sont, si l’on regarde du côté des femmes, un moment d’individualisme forcené. D’un côté, c’est une grande libération, elles ne sont plus dans la famille – et c’est une grande première ! – et la question de l’individu se trouve posée. Et, de l’autre, il n’y a plus ce tissu social que nous avions vu dans les années 30. C’est aussi le moment où les femmes ont le droit de vote. C’est comme si, tout d’un coup, elles accédaient enfin à l’universel. Elles ne sont plus obligées de dire qu’elles sont des femmes. C.G : Pour les Françaises, c’est la rupture. C’est dans ces années 50 que se marque leur libération dans ce que l’on doit faire en tant que femme. Elles sont des individus. Elles peuvent se permettre d’être des créatrices à part entière. Elles sont un individu, puis des femmes. Mais, en même temps, le fait de s’affirmer en tant qu’individu qui crée, cela implique une rupture avec le social, tu n’es plus une épouse, tu n’es plus une mère… E.L. : On le voit bien, par exemple, avec Marie Raymond. Par rapport à Fred Klein, ce n’est pas lui l’artiste. Bien sûr, quand elle se marie avec lui dans les années 20, Fred est plus artiste qu’elle, mais après la guerre, elle devient une créatrice. Elle fait ses peintures, elle expose partout, elle rencontre un grand succès, elle remporte en 1949 le prix Kandinsky, elle tient un salon où Yves croisera toutes les figures essentielles de l’après-guerre. Et puis, nous avons aussi mis ces changements en parallèle avec le mouvement des galeristes femmes. Jeanne Bucher avant la guerre, Denise René, Colette Allendy, Iris Clert. C’est le même cheminement. Ce sont des femmes qui décident de se consacrer complètement à leur travail de galeriste. Elles sont d’abord reconnues comme galeristes, et pas en tant que femmes. Ce sont des galeristes, ou des artistes, et après des femmes. Le mot a donc changé : c’est « femme artiste » au début, là, c’est « artistes » puis « femmes ». D’où notre titre ! Et dans ces années 50, les artistes femmes sont-elles achetées ? E.L. : Non. Là, il y a vraiment un problème. Le marché de l’art tel qu’on le connaît aujourd’hui se crée aux États-Unis. C’est la fin des années 50, c’est le moment où le marché de l’art et l’art moderne sont à New York. À Paris, les choses sont beaucoup plus difficiles et les artistes femmes ont peu d’expositions. En plus, se pose la question du prénom. Les femmes retirent leur prénom pour signer leurs œuvres. Elles ont peur que les collectionneurs ne les achètent pas parce qu’elles sont des femmes. Plus largement, la conception de l’art change beaucoup dans les années 50. Dans toute la première partie du XXe siècle, on a, d’un côté, les avant-gardes, de l’autre, tous les retours à l’ordre, les classicismes, tous ces rapports académiques à l’art. Après les années 50, on a l’impression que tout cela se sépare. Et, finalement, ce qui va devenir l’art contemporain s’impose et se spécialise surtout. Et toutes ces stratégies qu’avaient inventées les femmes pour poursuivre un travail dans un monde qui, somme toute, acceptait mieux certaines formes d’art, ne peuvent plus fonctionner, exister dans un moment de radicalisation des formes. Les années 50, c’est le goût de la nouveauté, le développement des musées d’Art moderne en France et dans le monde, et une spécialisation des tendances nouvelles, plus internationales aussi, où les femmes ont du mal à s’insérer. Quand on interroge des artistes comme Annette Messager, qui ont fait leurs études dans les années 60, on voit bien qu’il y a un sexisme très violent qui règne dans les arts plastiques, dans les écoles, en particulier. On voit bien, là, que le monde de l’art – les institutions, les collectionneurs, les critiques – est fermé. Les années 70 changent-elles la donne ? E.L. : Oui, on peut dire, effectivement, qu’en 1970, le féminisme va totalement changer la donne. On peut se poser plusieurs questions : est-ce que ce sont les mouvements de femmes liés au féminisme qui ont changé cette donne ? Est-ce que ce sont les artistes femmes ? Est-ce qu’un travail est féministe sans que les femmes aient adhéré elles-mêmes au mouvement des femmes ? Pour nous, oui. Il est sûr que le travail de Gina Pane, celui d’Annette Messager sont bien plus féministes que celui de bien d’autres artistes qui ont travaillé à l’intérieur du mouvement des femmes. Là, le féminisme change la donne du monde de l’art. Parce qu’il a obligé à s’interroger sur ces questions. Donc, qu’est-ce qui est le plus important ? Changer les formes ? Qu’il y ait plus de femmes dans les institutions ? Ou que l’art ne soit plus là où l’on veut qu’il soit ? C’est une question qui reste aujourd’hui ouverte. Mais elle est là en 1970 : où est l’art ? Est-ce que quand tu es une femme féministe, il vaut mieux entrer au Musée d’art moderne ? Est-ce cela le but du féminisme ? Ou est-ce de complètement bouleverser les institutions et qu’il n’y ait plus de Musée d’art moderne ? Mais, au-delà, de ces questions posées au début des années 70, il faut quand même bien voir que la reconnaissance des femmes artistes, en France, est bien plus tardive. Elle date de la fin des années 90, et encore. C’est une réalité que l’on n’aime pas trop penser. Bien sûr, dans les années 70, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d’expérimentations artistiques, l’utilisation de la vidéo, la performance, l’attention portée à d’autres modes d’expression que la peinture ou la sculpture, comme l’installation, l’intérêt anthropologique pour les objets, etc. Tous ces déplacements esthétiques où les femmes sont leaders. Et puis, il y a tout ce travail que les femmes font sur leur propre construction. Annette Messager s’invente un genre femme artiste. C’est ce qu’elle dit dans notre entretien : « Je me sens plus femme en tant qu’artiste que dans la vie. » Mais, réellement, les choses n’ont vraiment changé que très très récemment. Paradoxalement, elles se sont accéléré avec l’exposition Dionysiac, à Beaubourg. Dionysiac a mis le feu aux poudres d’un « truc » où les Françaises n’osaient pas tellement intervenir. Celle du genre. Alors que dans d’autres pays, existent depuis longtemps les gender studies. Et c’est une question pour nous cruciale à étudier, à relire aujourd’hui : ce fameux universalisme républicain. Et le « retard » des musées français sur ces questions du genre est dû, en grande partie, à cet universalisme républicain. Il ne s’agit pas de repenser la question en termes de statistiques mais en termes d’influence. Quels effets cet universalisme produit sur les artistes ? Qu’est-ce que le modèle du musée républicain peut dire aujourd’hui ? C’est à cela maintenant qu’il faut réfléchir.
< 1 >
commentaire
écrit le < 29'03'09 > par <
mylene.mimoun fim gmail.com
>
Bonjour ! Je suis tombée sur votre article fort intéressant. D’ailleurs, fait cocasse, j’ai posée cette réflexion en prenant un cours en art moderne et aussi en cinéma contemporain. La place des femmes était quasi inexistante, et pourtant, elles ont du talent autant que la gente masculine ! Enfin, je voulais savoir où se trouvait votre livre. J’habite Montréal, au Québec. merci ! Mylène Mimoun 
< son > The Residents, une interview exclusive
< Discussion > Field recording, un art écolo ? < Interview > Pascal Comelade, interview d’un « travailleur musicien » < Son > « Liliane Song », par Jean-Philippe Renoult < Interview > La Ribot : « J’invente des situations catastrophiques pour l’art et la danse » < son > Melvin Van Peebles revient sur ses mille et une vies < son > European Sound Delta, récit au fil de l’eau < PDF > DotRed, le livret < vidéo > La sélection clips de poptronics pour Art Rock 08 < son > Avec DJ Food, un festin de Ninja < Entretien > Annie Abrahams, Nicolas Frespech, l’un l’entretien de l’autre < PDF > « Global Techno », extraits < vidéo > La sélection poptronics pour le festival de Clermont-Ferrand < vidéo > Guillaume zappe la télé < son > Soirée poptronics, l’after en remix sonore < aperçu > « Second Life, un monde possible », extraits < cartes postales > De Shangaï au Morvan, cartes postales pop |